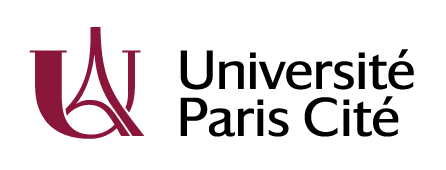< Thomas Bartholin
Historia anatomica
sur les lactifères thoraciques (1652)
chapitre xix >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1039
(Consulté le 03/06/2024)
si longtemps cachés ? [1][1][2]
À la suite de nos expériences sur les nouveaux lactifères, [3] nous avons beaucoup réfléchi et tiré maintes déductions ; mais si le couteau de dissection fait demain des découvertes qui nous contrediront, nous reconnaîtrons et conviendrons publiquement qu’il faut soit les enrichir de bonne grâce, soit [Page 67 | LAT | IMG] modifier modestement tout ce qui s’y sera montré douteux ou faux. Nous nous sommes donné pour loi de vénérer ce que la nature a prescrit.À la manière de Coronides nous ajoutons deux questions : [2][4] 1. pourquoi la nature a-t-elle voulu que de si remarquables vaisseaux aient jusqu’ici échappé aux anatomistes, qui sont pourtant réputés avoir des yeux de lynx ? 2. par quelle méthode ou opération, dont ils disposaient déjà, d’autres que nous auraient-ils pu les voir et les démontrer ? Diverses raisons peuvent expliquer pourquoi leur observation a précédemment été négligée. [5] En tout premier lieu, nous reprochons à la nature d’avoir été plus favorable à notre siècle qu’à tous ceux qui l’ont précédé car, jalouse de ses secrets, elle nous ensorcelle les yeux pour nous empêcher de voir ce qui est fort évident. Pour marque certaine de sa divine vindicte, cette impuissance à voir et à réfléchir a abandonné le monde à ses disputes, pour qu’il ne découvre pas la vérité, pour qu’écrire des livres ne connaisse aucune fin et que l’homme passe sa vie à lire tant et plus (Ecclésiaste, 12:12). [3][6] Puisque nous avons tenu pour certain que toutes les veines lactées se rendent du pancréas [7] au foie, nous nous abstenons de chercher plus loin. L’autorité de Galien [8] a tant prévalu sur toutes les autres qu’on s’est unanimement accordé à croire que le foie assure seul la transformation de la totalité du chyle en sang. [9] À cela s’est ajoutée la situation très profonde des nouveaux lactifères qui les rend difficilement accessibles à la vue et à la main des opérateurs. Nul n’était rien allé chercher de tel tout au fond du thorax quand l’attention y portait entièrement sur le mouvement qu’y accomplissent le cœur et le sang. Il n’y a aucun doute qu’on y a vu ces canaux, mais on les a pris soit pour des nerfs soit pour des veines vides, soit pour de la graisse, soit pour de fines membranes. Les lactifères [Page 68 | LAT | IMG] thoraciques se font en effet prendre soit pour des nerfs, auxquels ils ressemblent beaucoup, soit pour de simples filaments, quand ils se sont vidés de leur humeur laiteuse. La sixième paire nerveuse [10] descend de chaque côté du rachis dorsal, et deux particularités nous ont appris à la distinguer des lactifères thoraciques : [4] 1. les nerfs serpentent latéralement et se terminent dans le diaphragme ou dans ses insertions, tandis que les veines lactées cheminent au milieu, sur l’épine dorsale, se trouvant en haut entre elle et les nerfs de la sixième paire qui la flanquent de part et d’autre, et plus bas, elles traversent le diaphragme pour rejoindre les glandes lactées lombaires dans l’abdomen ; [11] 2. à la différence des lactifères, quand on incise les nerfs, il ne s’en écoule aucun liquide, et quand on les lie, ils ne gonflent pas. On peut ajouter à cela l’origine ou insertion des uns et des autres : les nerfs proviennent du cerveau, tandis que les lactifères viennent de l’abdomen et se terminent dans la veine axillaire. [12][13] Souvent aussi, nous avons confondu les lactifères avec une sorte de gras : je les ai cherchés dans le thorax d’une vache qu’on avait précédemment alimentée, mais ils étaient si noyés dans la graisse que je ne vis rien d’autre que des filaments fort difficiles à dissocier. Il en va de même pour les nouvelles glandes lactées lombaires ou pour le réservoir [14] auxquels les anatomistes ont souvent donné le nom de glandes mésentériques, qu’ils connaissaient déjà, ou de graisse. Ce qui était demeuré de tout temps invisible est apparu à Pecquet, il confesse donc ingénument dans son chapitre ii que ce « présent de la bonne fortune jouant avec un ignorant » a fait de lui le plus heureux des mortels. [5][15][16]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |