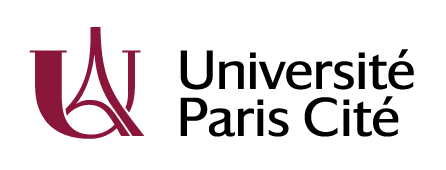< Thomas Bartholin
Historia anatomica
sur les lactifères thoraciques (1652)
chapitre xviii >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1038
(Consulté le 03/06/2024)
Il ne semble pas tout à fait impossible que les lactifères thoraciques, qui sont voisins des mamelles, contribuent en quelque façon à y distribuer du lait. [2] Galien, au chapitre iii du Livre sur ses propres ouvrages, dit qu’il a rédigé un Épitomé des œuvres de Marinus, qui, dans le livre iv de son Anatomie, parle de vaisseaux mammaires contenant du lait ; [2][3][4] si elle avait été conservée, peut-être aurait-elle été utile à notre savoir. Certains auteurs se seraient convaincus d’avoir vu, dans le thorax humain, des branches laiteuses gagnant les mamelles, mais je crains que les nerfs qui y descendent ne les aient induits en erreur. Maints indices incitent à penser comme Hippocrate, dans son Livre sur la Nature de l’enfant, [5] que du lait ou du chyle est poussé vers les mamelles, et j’ai naguère dit ce que j’en pensais dans mon Anatomie réformée. [3][6] Les nourrices déclarent d’elles-mêmes que quand elles tendent les seins aux nourrissons, [7] le lait semble leur descendre des épaules (où s’insèrent les lactifères thoraciques), [8] non sans une sensation douloureuse, et redoutent franchement que ce qu’elles mangent ne gagne leurs mamelles par crainte de se charger en aliment mal digéré. De plus, [Page 63 | LAT | IMG] on observe que quantité de matières absorbées avec la nourriture sont transportées dans les seins des femmes avec le lait. Martianus [9] en a consigné l’exemple, vu à Rome, de l’épouse d’un maçon qui, dans l’heure suivant la prise d’un médicament purgatif, [10] tendit son sein à la fillette d’un an qu’elle allaitait, et en raison d’un si bref intervalle, l’enfant en fut si rudement purgée qu’on craignit qu’elle en mourût ; mais la mère n’éprouva aucun effet du remède. Hippocrate, dans les Épidémies, [11] fait la même remarque à propos d’une chèvre et d’une femme qui avaient pris de l’élatérium, [12] et d’autres ont écrit sur les laits, comme Theophraste, [13] Dioscoride, [14] Varro, [15] Massaria, etc. [4][16] Au témoignage d’Aristote, livre vii de l’Histoire des animaux, [17] chapitre xi, des poils avalés en buvant ressortent par les mamelons, soit isolément quand on les presse, soit avec le lait. [18] Le susdit Martianus raconte encore que le fils de Domitia Griffoni, âgé d’un mois, a très souvent exonéré du bran dans ses fèces, parce que sa nourrice mangeait du pain de son. Toujours à Rome, on a extrait du mamelon d’une femme allaitante un brin de chicorée qu’elle avait mangé au cours de son précédent repas. Enfin, pour se purger, Pompilia, épouse de Melsi, avait avalé six livres de lait de chèvre, [19] qui lui coulèrent très rapidement dans les mamelles, lesquelles enflèrent avec de très intenses douleurs. [5] Hippocrate, dans son Livre sur la Nature de l’enfant, parle de veines qui vont à la matrice et aux mamelles, mais sans expliquer quelles elles sont, [3] et Martianus, dans ses annotations sur le Livre des Chairs, [20] admet l’existence de canaux lactés cachés qui entrent et sortent des mamelles. [6] P. Castellus, dans son livre ii des Émétiques, chapitre xlix, soupçonne que la matière du lait parvient aux mamelles en empruntant soit des voies encore inconnues, soit les porosités qui sont dans les tissus flasques. [7][21] Vesling, dans la dernière édition de son Syntagma, [Page 64 | LAT | IMG] admet des vapeurs laiteuses empruntant des voies qui échappent encore au regard. [22] Jo. Dan. Horst, dans la première partie, section ii, chapitre i de son Guide pour la médecine, met hardiment en avant l’existence de veines lactées et rouges dans les mamelles. [23][24] J.C. Benedictus, lettre v, livre iv des Épîtres médicales, défend certes Hippocrate, mais approuve le fonctionnement conjoint de l’utérus et des seins. [25][26] Rien ne résout mieux ce débat que les nouveaux lactifères du thorax : voisins des mamelles et de la cavité thoracique, ils envoient des rameaux de tous côtés, et il serait aisé d’en chercher la preuve en disséquant une femme enceinte ou allaitante qui serait morte après s’être nourrie. [8][27]Il n’est pas si simple d’observer cela dans le sexe masculin, à moins que les mamelons ne regorgent de lait, ce qui est rare, mais se voit pourtant parfois, surtout chez les enfants. [28] Chez le voleur dont nous avons récemment fait l’anatomie, un sérum bilieux [29][30] s’écoulait du thorax par les vaisseaux mammaires ; [31][32] mais leur anastomose avec les épigastriques, que les anatomistes ont tant vantée, est si rarement visible que, dans mon expérience, elle a plus souvent fait défaut qu’existé, et on se demande bien comment elle pourrait être la source d’une telle abondance de lait. Riolan, anatomiste qui a blanchi sous le harnais, a certes décrit dans le chapitre iii, livre iii de son Anthropographie, [33] chez une parturiente récemment décédée, une artère mammaire interne et une épigastrique dont l’épaisseur et le calibre égalaient ceux d’une plume à écrire ; mais il faut attribuer cela à une stagnation prolongée du sang ou au ralentissement de son mouvement, ou aux efforts de l’accouchement, puisqu’ils dilatent fort quantité d’autres vaisseaux qui entourent l’utérus, comme Beslerus l’a dessiné dans la figure iii de son Anatomie de la femme. [34] Qui plus est, dans son addenda, Riolan a observé, en compagnie de son collègue M. Matthieu, [35] de semblables dilatations variqueuses chez un homme originaire de la Marche, [Page 65 | LAT | IMG] qui s’étendaient sur toute la longueur du ventre, depuis le thorax jusqu’au pubis. Chez une chienne gravide qu’il disséquait vivante, [36] le très diligent Highmore, au livre ii, première partie, chapitre iii, de sa Recherche anatomique, [37] a ouvert la grande veine azygos, [38] dans laquelle se déversent les intercostales, et vu s’écouler des dites veines une humeur laiteuse mêlée au sang ; comme elle était exactement de même nature que celle qu’on trouve dans les mamelles, il suspecte qu’elle provenait des artères thoraciques et mammaires. [9] Pour ma part, je crois pourtant qu’une branche du canal thoracique, insérée dans l’azygos, y a déversé une partie de son chyle puisque, chez les chiens et d’autres bêtes qui ont les mamelles attachées à l’abdomen, il est fort rare qu’elles communiquent avec les artères intercostales ou thoraciques. Pour examiner cette question, je me suis mis à la recherche de chiennes gravides ou allaitantes, dont je m’occuperai le moment venu, quand j’en aurai fini avec cette présente thèse.
Pecquet dit n’avoir pas vu de lactifères gagner les mamelles, et le très savant Auzout [39] explique cela par la position des vaisseaux lactés chez les bêtes qui ne leur ouvre pas de communication facile avec elles ; [40] mais le contraire me semble plus vraisemblable puisque leurs mamelles sont plus proches de l’abdomen que celles de la femme qui porte ses petits dans les bras, comme a pensé Aristote. Cela fait que chez les très nombreux chiens que nous avons disséqués, nous avons vu que les veines lactées sont rares dans le thorax, mais innombrables dans l’abdomen, et ce sont sans doute celles qu’Érasistrate [41] y a observées chez les chèvres. Au livre vii, chapitre xxii, de l’Utilité des parties, Galien [42] a donné les raisons pour lesquelles l’être humain est presque le seul à avoir les mamelles sur le thorax, alors que la plupart des bêtes les ont sur l’abdomen ; mais d’autres l’ont expliqué autrement. [10] Selon la tradition des rabbins, Rabbi Abha dit que Dieu a posé les seins des femmes devant la région du cœur [Page 66 | LAT | IMG] pour que l’enfant en tire courage et sagesse, Rabbi Jehuda, pour que l’enfant ne soit pas obligé de voir les parties honteuses de sa mère, et Rabbi Matthana, pour qu’il ne soit pas obligé de téter dans un lieu malpropre, au rapport de Buxtorfius, chapitre iii de sa Synagoga Judaica. [11][43] En outre, si la supposition d’Hippocrate était vraie, je conjecturerais volontiers que le chyle qui va dans les mamelles humaines est fort cru et recherche plus avidement la chaleur voisine du cœur que ne fait le chyle plus robuste des chiens et des autres quadrupèdes, chez qui il vient de l’estomac et n’est pas exposé aux dommages externes car le rachis courbé vers le sol protège leurs mamelles, comme Galien l’a remarqué à la fin du chapitre précédemment cité. Quant à l’autre argument d’Auzout et à sa singulière expérience, [44] Castellus en répond à la page 180 de ses Emetica, livre ii, chapitre lix, sur une question qui n’est guère différente, car ce problème peut s’examiner pareillement dans le thorax et dans l’abdomen. [12] J’apprends qu’a récemment paru à Rouen un opuscule de Guiffart [45] sur la substance ou matière du lait, où il nie qu’il s’agit de chyle apporté par le canal pecquétien, [46] mais je serai contraint d’ignorer sur quels nouveaux arguments et expériences il se fonde tant que les libraires ne nous auront pas procuré son livre. [13]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |