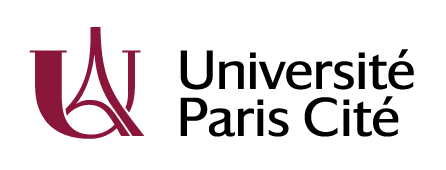< Clypeus
de Guillaume de Hénault,
alias Jean Pecquet (1655),
5e et dernière partie >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1045
(Consulté le 03/06/2024)
Écoutons Le Noble : [2] « Je prétends que, par les voies indiquées plus haut, [3] une autre partie du chyle, principalement celle qui est aqueuse et déliée, s’écoule finalement dans le cœur, [4] non pas certes pour y être transformée en sang [5] (car, comme nous l’avons dit, seul le foie assure cette sanguification), [6] mais pour y recevoir, en même temps que le sang, le sceau de la faculté vitale, que communique le fécond et admirable rayonnement du cœur ; [7][8] et pour gagner ensuite les parties plus froides et humides du corps, et les vivifier par la nourriture bien tempérée qu’elle leur procure car, à n’en pas douter, la nature n’aurait pas mis à leur disposition cet aliment. » [1] Cette opinion présentée comme nouvelle ne plaira pas à Pecquet car, si la nature avait voulu nourrir de chyle les parties plus froides et humides, elle eût certainement trouvé plus convenable de l’envoyer dans le foie que dans le cœur, qui est plus chaud que lui, pour que cet aliment reste froid et humide ; et il s’ensuivrait alors que, contrairement à l’opinion qu’il défend, le foie ne serait pas l’organe principal et universel de la sanguification car, à tout le moins, il ne fabriquerait pas le sang destiné à nourrir les parties plus froides et humides du corps ; il s’ensuivrait aussi que certaines parties ne seraient pas nourries par le sang, ce qui est absurde, car toutes se forment [Pages 66‑67 | LAT | IMG] directement ou indirectement à partir du sang ; toutes doivent donc en être alimentées. La nature a néanmoins destiné le chyle à vivifier les parties très froides et humides, et des circulations continues, rapides et répétées le porteraient au foie, où il se transformerait continuellement en sang, comme il est forcé de l’admettre. Les parties très froides et humides resteraient donc privées de leur génie familier ; quant aux parties charnues qui se nourrissent de sang, surtout au cours des efforts et des jeûnes prolongés, elles pourriraient alors qu’elles étaient précédemment solides. Cela est contraire à l’expérience et à la médecine. [2]Voici son raisonnement : « Si le foie avait en effet la faculté de transformer tout le chyle en sang, ces parties manqueraient de l’aliment qui leur convient car, étant de tempérament très froid, elles repoussent la chaleur du sang pur qui leur est contraire et peut leur nuire. » Il suppose néanmoins que le sang pur est très chaud, puisqu’il est doux, mais qu’il a été tempéré, de façon à nourrir toutes les parties. L’action ne se ferait pas sur des choses identiques ou analogues, mais sur des choses contraires : bien que le sang soit chaud, ou du moins tempéré, la transformation, qui est la féconde mère de la nutrition, en ferait un aliment qui convient aux parties froides ; les parties froides et humides ne devraient donc pas se nourrir d’un aliment porteur du même froid qu’elles. Dans la suite de sa lettre, Le Noble ajoute bien des arguments qui sont à tenir pour neutres, car ils n’apportent rien en faveur ni en défaveur de son opinion. Il les tire tous fortuitement de l’hypothèse qu’il propose, mais ne démontre pas. Ils ne sont que probables et resteraient fragiles, [Pages 68‑69 | LAT | IMG] même si son raisonnement se fondait sur des bases solides, alors que Pecquet peut bien mieux les expliquer avec la doctrine que les constats de ses expériences ont construite : le chyle est fort aqueux, de manière à s’écouler facilement dans les veines lactées qui sont extrêmement fines ; et la nature a détourné les lactifères vers le cœur, au-dessus du foie, pour que le chyle subisse une meilleure préparation en empruntant un chemin plus long. [3]
Quant au moteur qui pousse le chyle vers le haut, il réside dans la contraction des intestins, [9] des muscles lombaires [10] et abdominaux [11] ou du diaphragme, [12] dans les battements artériels [13] ou dans la respiration, [14] à quoi Le Noble estime que s’ajoute le péristaltisme des chylifères. [15] Nous n’en discuterons pas ici, mais dirons seulement que ces vaisseaux sont naturellement si fluets que, s’ils se meuvent, il ne s’y forme ni rides ni renflements, comme on en voit dans les intestins ; et qu’en outre, ils sont si étroitement enceints de tous côtés par des membranes si solides, comme lui-même en convient, qu’on peine à croire qu’ils soient animés d’un mouvement vermiculaire. Nous portons le même jugement sur ce qu’il dit des constrictions qui surviennent à la partie supérieure de ces canaux, ou des dilatations remplies de chyle qui s’y forment. [4]
Voilà qui est bien suffisant, très distingué Monsieur : [16] même si les traits qu’on a lancés contre le cœur ont pu l’atteindre et si personne ne les en retirera jamais, ils n’ont pu pénétrer jusque dans ses parties les plus profondes. Notre riposte n’a pourtant pas été inutile ; la tyrannie du foie est tombée du haut de son pinacle et la voici, je pense, privée de tout secours extérieur car
si Pergama dextra [Pages 70‑71 | LAT | IMG]
defendi possent, etiam hac defensa fuissent. [5][17]Le cœur est donc rétabli dans son empire, d’où on l’avait si longtemps banni. Bien qu’épuisé par le long et ingrat effort du combat, il récupère ses forces, il vit, il vainc, il triomphe : il transforme et transformera dorénavant le chyle en ce sang qu’à ses très généreux dépens, il distribue à toutes les parties du corps qui lui sont soumises. Si cette victoire mérite la louange, c’est à vous seul que j’en attribue entièrement la paternité : du haut du trépied, [18] enflé par quelque volonté divine, c’est vous qui m’avez jadis inspiré la force et l’audace, qui avez raffermi mon courage, qui m’avez ceint des armes triomphantes. [19][20] Vive donc le cœur, très noble Monsieur ! Puisse le vôtre vivre de nombreuses années encore, tant pour vous que pour la postérité. Recevez, je vous prie, cet immortel trophée en souvenir perpétuel de cette découverte, que j’érige sur les ruines éparses du foie, et que je dédie de toute mon âme à votre immense renom. [6][21]
De Rouen, le 25e du mois de juin 1655.
[FIN.]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |