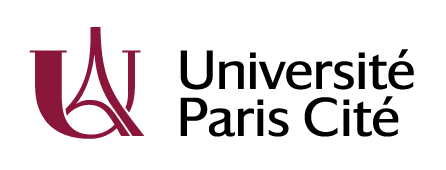< Clypeus
de Guillaume de Hénault,
alias Jean Pecquet (1655),
4e de cinq parties >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1044
(Consulté le 03/06/2024)
Le Noble [2] attribue la sanguification au foie : [3] « Il ne sera pas non plus inutile que je cite cette maladie assez commune que les moutons attrapent en broutant de la renoncule flammule, à laquelle les bergers donnent en France le nom de douve : [4] on leur trouve le foie entièrement gâté et corrompu, souvent envahi d’innombrables vésicules remplies d’eau, où sont toujours éparpillés de petits animaux ou bestioles, dont la forme est semblable à celle du poisson qu’on appelle la sole ; leur multiplication dans le foie provoque sa pourriture, son érosion, et finalement parfois sa destruction ; les germes de cette putréfaction se montrent d’abord et pullulent dans les parties de ce viscère qui jouxtent les branches de la veine porte [5] car c’est là, si je ne me trompe, qu’arrive le chyle empoisonné et corrosif ; [6] il n’y a donc pas à s’étonner si les bouchers et les bergers, en examinant certaines veines des yeux (car cet épuisement du foie provoque un effondrement de la sanguification) [7] présument que des moutons sont atteints de cette maladie ; elle ne provoque pourtant aucun dommage du cœur, [Pages 49‑50 | LAT | IMG] qu’elle aurait certainement dû léser et ruiner plutôt que le foie, mais c’est là que le chyle destiné à se transformer en sang subit son altération première, tandis que la partie du chyle qui se précipite directement dans le cœur en est continuellement expulsée. » [1] Il tire inutilement argument de cette expérience, car il est aussi bien connu que les cantharides ingérées ou appliquées sur la peau provoquent des ulcérations de la vessie urinaire, sans pourtant que cette destruction ne provoque le moindre dommage hépatique ; ce mal aurait certainement été plus susceptible de léser et gâter le foie que la vessie, parce que les cantharides ou leur poison traversent le foie avant d’aller dévorer la vessie. Si on approuvait et admettait son raisonnement, la renoncule flammule et les cantharides, devraient léser l’estomac, les intestins, le mésentère, la veine porte et d’autres parties puisqu’elles y passent avant d’atteindre le foie et la vessie. [2][8][9] Certains maux, dont la cause est occulte, affectent les corps par sympathie et antipathie. [10] Si du moins cette réponse ne le fait pas sourire, il est certain que, pour qu’un agent produise un effet, il faut, outre sa puissance élevée, que la disposition du patient y soit favorable. Il n’est donc pas étonnant que manger de la renoncule flammule soit nuisible pour le foie ; et c’est pourquoi le sang chargé de bile ne provoque ni péripneumonie [11] ni inflammation cardiaque, [12] bien qu’il soit d’abord transporté dans le cœur, puis dans les poumons. [13] Il est plaisant de retourner sa flèche conte lui : dans la phtisie, [14] [Pages 51‑52 | LAT | IMG] dans l’inflammation de la rate, [15] des reins, [16] de l’utérus [17] ou de quelque autre partie du corps, la putréfaction, où qu’elle naisse corrompt le sang, par l’irruption d’une humeur peccante ou par l’émanation d’une vapeur néfaste ; et puisque la sanguification s’en trouve affectée, ces diverses parties sont donc autant d’officines du sang : ô la belle argumentation que voilà !Le Noble met en cause l’exiguïté des lactifères de Pecquet : [18] « Voici encore d’autres arguments qui consolident mon opinion : les veines lactées de Pecquet sont grêles quand on prend en compte la taille du corps et celle des lactifères mésentériques, qui sont non seulement plus gros mais beaucoup plus nombreux que les thoraciques. » [3] Il adresse ensuite le même reproche aux autres chylifères : « Le réservoir du chyle [19] est extrêmement étroit. La capacité du ou des canaux pecquétiens (mais il n’y en a plus souvent qu’un) est fort réduite et resserrée. » [20] Je ne vois pourtant pas en quoi cette étroitesse consolide son opinion. [4] L’exiguïté de ces vaisseaux est destinée à rendre le chyle plus aqueux, en empêchant la partie la plus grossière des aliments d’y pénétrer, afin de ne pas les obstruer [21] et de ne pas épaissir le sang. Le chyle n’a pas besoin de canaux aussi larges que le sang, car il est beaucoup moins humide que lui. L’observation anatomique confirme cette explication : le chyle gagne ses vaisseaux en s’infiltrant à travers les pores invisibles des intestins ; [22] Le Noble a donc tort de déplorer l’étroitesse des veines lactées, car elles sautent aux yeux de ceux qui en ont. Il n’y a pas non plus d’intérêt à distinguer plusieurs sortes de lactifères parce que le chyle ne les dilate que fort peu : il s’en écoule toujours très vite vers le haut, comme on le constate fort bien [Pages 53‑54 | LAT | IMG] après la mort, à tel point que si on tarde à ouvrir le cadavre, aucun chylifère n’est plus visible ; c’est pourquoi l’anatomiste dissèque le supplicié aussitôt après qu’il a été pendu. [23][24] Le même raisonnement s’applique au réservoir, dont Le Noble fait remarquer l’étroitesse, et la faible capacité des canaux pecquétiens.
Il continue ensuite à plaider la cause du foie : « En divers endroits de la face inférieure du foie, les rameaux qui naissent de la veine porte sont plus gros et nombreux que ceux de la veine cave inférieure à sa face convexe [25] (nous avons observé que les branches de la porte comme de la cave, qui se dispersent dans la substance hépatique, sont percées d’innombrables trous, à la manière d’un tamis). Qui plus est, les veines mésentériques [26] sont plus grandes et bien plus nombreuses qu’il n’est nécessaire pour recevoir la quantité de sang que leur délivrent les artères qui irriguent les intestins ; [27] et de fait, si la totalité de la nourriture leur arrivait, la portion du sang et des esprits [28] qu’il leur faudrait charrier serait bien plus importante que celle dont le cerveau a besoin. » [5][29] Cette inégalité de nombre et cette différence d’épaisseur entre les branches de la veine porte et de la veine cave [30] ne nuisent pas à Pecquet mais ne reçoivent pas son suffrage. [6][31][32] Les branches de la veine porte devaient être plus grosses et nombreuses que celles de la veine cave parce qu’elles contiennent un sang plus épais que les racines et ramifications sus-hépatiques, de manière que le sang se décharge plus rapidement et finement de sa bile jaune. [33] Les ramifications de la veine cave sont en vérité plus étroites et moins [Pages 55‑56 | LAT | IMG] nombreuses parce que le sang, une fois débarrassé de ses excréments, [34], est plus fluide, et s’y écoule plus aisément et rapidement. Le plus gros calibre et le plus grand nombre des veines mésaraïques, en vue peut-être d’assurer l’alimentation des intestins et du mésentère, bien que nous ne soyons pas d’accord avec Le Noble là-dessus, ne prouvent rien contre la doctrine pecquétienne, car il arrive que la taille et le nombre des artères et des veines dépassent les besoins nutritifs de plusieurs parties du corps, comme on le voit dans le cerveau, le cœur, la rate, les reins, l’utérus, les testicules, et ce à diverses fins. Pecquet pourra légitimement lui répondre que cette disproportion entre l’apport des vaisseaux et l’alimentation vise à favoriser la chaleur native [35] des intestins et des vaisseaux chylifères car ils subissent perpétuellement la froideur de l’esprit et du sang qu’ils contiennent, et à permettre ainsi une fermentation et perfection plus poussées du chyle. En un mot, en traversant ces conduits conformes à la nature, comme δια των χωριων συμφεροντων, cette chaleur concourt à la purgation des humeurs excrémentielles venant des première, mais aussi deuxième, et parfois troisième régions du corps, par des diarrhées en tous genres. [36] Le Noble a pu se tromper, étant donné que c’est un exercice difficile, en comptant les artères et les veines mésentériques, car les artères, qui étaient enflées d’esprit, s’affaissent une fois qu’il s’est dissipé et échappent alors au regard. Quand bien même les aurait-il exactement dénombrées, il n’est pas obligatoire que s’établissent des jonctions et anastomoses [37] absolument parfaites entre toutes ces veines et artères, jusqu’aux plus fines. Néanmoins, pour ne pas paraître avoir adhéré si peu que ce soit au raisonnement de Le Noble, Pecquet lui réplique que les veines mésentériques seraient très nombreuses et [Pages 57‑58 | LAT | IMG] grosses parce qu’elles contiendraient un sang plus épais et plus abondant qui, se déplaçant fort lentement, devrait donc regorger ; d’autant que sa partie féculente, puisqu’elle n’a pas de faculté roborative, est à tout le moins inutile à la nutrition des parties qu’elle a irriguées. [7]
Le Noble défend le foie mordicus : « Sont à remarquer les voies ordinairement empruntées par le sang qui doit passer de la mère au fœtus pour l’alimenter, [38][39] où il n’y a absolument pas lieu de débattre sur le fait qu’avant de parvenir au cœur, il a pénétré dans les vaisseaux du foie, [40] pour y être à nouveau modifié et raffermi par une digestion plus complète, et pour en sortir mieux disposé à nourrir la totalité du corps, car il a plus facilement et sûrement reçu l’empreinte de la faculté vitale. » [8] Pecquet soutiendra que la veine ombilicale conduit le sang au foie pour qu’il y soit à nouveau purgé de sa bile (étant donné que cet organe est le seul capable d’extraire et éliminer la bile), [41] et ce afin que le corps du fœtus soit bien tempéré, et non que le sang soit plus complètement digéré dans le foie, parce que, comme l’affirment les médecins, les parties du fœtus se développent en se nourrissant du sang très pur de la mère, qui a déjà été parfaitement digéré, et qui n’a pas besoin d’une préparation plus poussée pour nourrir le foie et lui permettre de fabriquer son parenchyme ; et d’ailleurs, quelle partie l’aurait ainsi préparé puisque le foie n’existe pas encore ? Si le sang avait besoin d’être plus profondément modifié, il aurait obtenu cela du placenta [42] plutôt que du foie, car le premier se forme avant le second.
Puis il s’en prend à nouveau au cœur en le persécutant de sa pique : « Si quelqu’un trouve ces objections [Pages 59‑60 | LAT | IMG] peu convaincantes et cherche refuge dans la louable expérience, je le conjure solennellement d’établir un lien intime et manifeste entre la circulation du sang et la sanguification cardiaque, en mettant au jour les voies qui mènent le sang au foie pour y être purgé avant que les artères ne le répandent dans tout le corps. » On se doit de satisfaire ses prières comme suit : le sang engendré dans le cœur s’écoule dans l’aorte, [43] puis dans l’artère cœliaque, [44] dont les branches éparses pénètrent dans la substance de la rate, [45] et plus précisément dans sa partie spongieuse, qui filtre le sang pour le débarrasser de son ordure et de son tartre ; le sang gagne ensuite les rameaux de la veine porte, dont les racines sont attachées à la partie concave du foie, dans lequel il pénètre afin d’être à nouveau filtré par le parenchyme hépatique, qui élimine la bile jaune qu’il contient ; il en sort pur et nettoyé par les racines, le tronc et les branches de la veine cave, pour revenir finalement dans le cœur ; et ces voies, où il va et vient ainsi, sont tout à fait probables et légitimes.
Le Noble tourne ensuite à nouveau ses armes contre le cœur : « Sans cette voie encore inconnue, dont la légitimité et la probabilité n’ont jamais été solidement établies, il subsiste l’absurdité de penser que le sang se répand dans les parties qu’il doit nourrir en étant mélangé à l’excrément bilieux. » En vérité, ce sang gagne l’aorte et, après un très court trajet, la rate puis le foie, mais il n’emporte pas ses deux excréments au-dessus ni dans les autres parties du corps, à la fois parce qu’il est lourd, ce qui le porte vers le bas, et parce qu’il est attiré par la rate et par le foie. [9] On pourrait aussi tirer un autre argument du fait que les reins ne devraient ni extraire ni éliminer le sérum [46] parce qu’il est mélangé [Pages 61‑62 | LAT | IMG] à toute la masse du sang qui, selon la doctrine circulatoire, tend à s’écouler vers le haut ; [47] et il n’aurait pas de motif à préférer descendre du foie dans les reins plutôt que d’en monter pour atteindre toutes les parties du corps ; mais tout son surplus finit par atteindre les reins. De plus, si une portion du suc mélancolique et de la bile jaune fort grossière a pu passer outre, elle se déposera dans la rate et dans le foie au cours d’une circulation suivante, car :
Noctes, atque dies patet atri ianua Ditis. [10][48][49][50]Il n’est pas absurde de penser qu’une petite portion des deux excréments susdits, qui est engendrée par un ou deux repas, se répand rapidement et sans dommage dans la masse entière du sang : à en juger sur le sang que la phlébotomie [51] tire de gens en parfaite santé, on voit qu’il est très souvent corrompu par son mélange à des humeurs autrement plus pernicieuses.
Je ne dis rien pour le moment sur les arguments qu’on trouve chez d’autres auteurs sur la question. Nous leur répondrons le moment venu, et si ce qu’ils disent ne nous plaît pas, nous serons d’autre avis qu’eux. À moins que leurs attaques ne deviennent plus véhémentes, cela ne détournera pas les nombreux sectateurs de Pecquet de sa nouvelle doctrine, et lui ralliera même bon nombre de ses opposants. C’est pourquoi Le Noble ne peut légitimement affirmer que « la plus grande partie du chyle passe dans le foie par les veines mésaraïques, qu’il y est transformé en sang, etc. » [11]
Il prévoit le danger qui menace son idée : « Le chyle qui coule dans les veines mésaraïques échappe aux yeux des observateurs, mais cela ne doit faire obstacle à mon opinion, car un examen plus attentif de la question [Pages 63‑64 | LAT | IMG] montrera aisément qu’il s’y trouve à la fois du chyle et du sang, et qu’ils s’y mélangent intimement l’un à l’autre. Cela n’est pas différent de ce qui se passe quand le chyle pénètre dans les veines subclavières ou axillaires, où il devient sur-le-champ impossible de le distinguer du sang, à ce que dit Pecquet lui-même, car il devient rouge, comme fait l’eau en prenant la couleur et l’aspect du vin dans lequel on la verse. » Il n’a pourtant pas résolu l’objection qu’il a nouée : avant de traverser les veines avec le sang, le lait, le sérum ou les deux biles jaillissent à l’extérieur en une perirrhœa, [52] qui n’est ni mélangée ni rouge, sous la forme de diarrhées, de règles, de lochies ou de vomi ; alors pourquoi donc le chyle perdrait-il sa couleur dans les veines mésaraïques ? Au moins devraient-elles être blanches là où elles naissent, quand les deux liquides ne se sont pas encore confondus, alors que le chyle qui arrive ne s’est pas encore mêlé au sang, car il lui faut pénétrer dans la veine avant de s’y disperser. Quand on verse de l’eau dans du vin, elle ne devient pas instantanément rouge, les deux liquides restent distincts l’un de l’autre pendant quelque temps avant de ne plus en faire qu’un seul. [12]
Destruit, ædificat, mutat quadrata rotundis. [13][53]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |