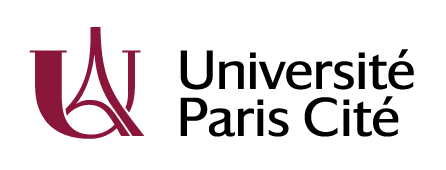< Hyginus Thalassius (1654)
alias Pierre De Mercenne,
Brevis Destructio de la
première Responsio (1652)
de Jean ii Riolan (1654) :
chapitre v >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=0054
(Consulté le 03/06/2024)
Utilité des lactifères. Leur connaissance ne modifie en aucune façon la véritable et hippocratique méthode pour remédier. [1][1][2][3][4] Quid non miraculo est cum primùm in notitiam venit ? quam multa fieri non posse priusquam sint facta judicantur ? Naturæ rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo, dit Pline dans le livre vii, chapitre i, de l’Histoire naturelle [2][5] Il ne faut donc pas s’étonner qu’au début, tous n’aient pas cru aux lactifères thoraciques et qu’ils aient paru improbables à la foule ignorante ; mais il est étonnant que l’homme qui se dit le prince de la science n’ait pas encore été suffisamment pénétré par la force et la majesté de la nature pour admettre leur existence, parce qu’elle est nouvelle, Dira imprecatione, ut Atlantes orientem solem solebant, contuitum fuisse. [6][7] Argumentis non est investigandum quod [Page 230 | LAT | IMG] experimentis cognitum est, dit le même éminent interprète de la nature ; [3][8] mais Riolan a injurieusement attaqué la découverte de Pecquet, blâmant la mauvaise utilité qu’il lui a conférée, et « souhaitant que les admirateurs de cette observation nouvelle démontrent en quoi elle est utile à la pratique médicale et à la guérison des maladies », page 157 de sa Responsio. [4][9] Quand il avoue pourtant ingénument « son ignorance », quand il « ne propose une opinion que fort froidement et tremblant, de même que les devins, qui ne disent rien que par les conjectures », [5][10] pourquoi veut-il que les jeunes soient plus sages que leur vieux maître ? Nunquid vis amplius quam ut de similem ducibus meis præsterem ? quid ergo est ? non quò miserint illi, sed quo duxerint ibo, dit Sénèque. [6][11] Il y a autant de différence entre scruter les œuvres de la nature, et concevoir leur utilité et leur dessein, qu’il y a de distance entre l’homme et Dieu : le premier découvre les choses et les montre aux autres, il relate ce qui se passe ici-bas ; mais le second révèle aux autres le dessein des choses et la raison pour laquelle il les a conçues, il relate alors ce qu’il a accompli dans le ciel. [7][12] Veros rerum fines, ut mundi extera, non capit humanæ conjectura mentis, nec interest hominum. [8] Il est dit dans La Sagesse, 9:13‑14, Quis enim poterit consilium Dei aut qui poterit cogitare quid velit Deus ? cogitationes enim mortalium timidæ et incertæ providentiæ nostræ. [9][13]Il nous est impossible de nier ou de mettre en doute l’existence des lactifères thoraciques, même si nous ignorons entièrement leur utilité, et si la nature cache sous son voile sacré le dessein de leur insertion. Qui saurait compter ce que le corps humain recèle encore de choses ignorées et incompréhensibles ? Riolan égalera pour moi le grand Apollon [14] s’il m’explique à quoi servent les nævus qui s’épanouissent à la surface de la peau : peut-être quelque chose en a-t-il parsemé sans ordre le corps pour faire joli, ou pour mieux nous faire voir que les contraires s’opposent aux contraires ? [10][15][16] [Page 231 | LAT | IMG] mais comment la disgrâce peut-elle trouver plaisir à enlaidir les parties du corps ou à obliger de les cacher ? Qu’il explique à quelle fin des poils poussent sur les doigts des mains et en quantité d’autres endroits, et quel avantage offre la diversité de leurs couleurs : pourquoi la chevelure est-elle rousse, blonde, noire ou blanche, frisée ou lisse ? Qu’il explique l’utilité des mamelles dans le sexe masculin, mais j’oublie qu’il l’a fait dans le chapitre iii, livre ii de son Anthropographie : [17] « C’est pour que la femme, qui est un animal orgueilleux, ne se glorifie pas d’avoir des mamelles, que la nature a refusées aux hommes » ! [11] Il est surprenant qu’en raisonnant de la sorte, il n’ait pas dit que la nature a fait l’homme hermaphrodite afin que la femme ne s’enorgueillisse aussi de l’utérus qu’elle est seule à posséder. Qu’il explique aussi à quelle fin les mamelles masculines produiraient du lait. [12][18][19] Il semble ne s’agir là que de vétilles, mais leur valeur est immense. Comme dit Pline, Mirum enim hîc quò procedat improbitas cordis humani, parvo aliquo invitata successu, et occasionem impudentiæ ratio largitur. [13] Les anatomistes devraient donc être plus modestes et prudents quand ils attribuent des utilités aux diverses parties du corps humain et les expliquent. Comme si la nature avait décidé de favoriser leurs défauts, les hommes abusent de ses limites jusqu’à l’intempérance : ainsi déclarent-ils hardiment que la substance de l’estomac est lâche afin de se dilater plus aisément et d’autoriser la gloutonnerie, comme si la nature avait attribué ce viscère à l’homme plutôt pour favoriser son ébriété que sa sobriété ; ainsi attribuent-ils aux organes une taille, une position et un nombre qui se révèlent parfaitement faux, sous prétexte qu’en certains corps leur taille, leur position et leur nombre peuvent varier sans empêcher lesdits organes d’accomplir naturellement leurs fonctions coutumières, comme l’illustrent les exemples de foie placé dans l’hypocondre gauche, avec le cœur et la rate à droite, [20] de double [Page 232 | LAT | IMG] rate ou de quadruples uretères. [21][22]
Tout organe a néanmoins de multiples fonctions : la première lui est propre, elle le dispose tout entier à l’action et repose sur son aptitude à l’accomplir, qui est elle-même fondée sur une composition adaptée à l’accomplissement de sa charge, dont la sollicitation précède l’action, que l’organe est toujours prêt à assurer, même quand il est au repos ; la deuxième fonction consiste à accomplir l’action, c’est la plus importante parce qu’elle exprime le dessein de l’organe, dont la portée ne se limite pas à lui-même, mais s’étend à l’ensemble du corps ; la troisième fonction est celle qui fait connaître l’organe et doit plutôt être appelée son utilité, car elle l’explique tout entier et donne accès à sa compréhension. En se fondant sur Galien, [23] Aselli a bien établi cette distinction. [14][24][25] Dans la première fonction, qui se rapporte à l’action, les anatomistes ne peuvent pas être induits en erreur, car elle est accessible au constat des organes sensoriels ; mais les autres fonctions ne leur sont pas accessibles, et leur interprétation est soumise au jugement de chacun. Je ne traite donc ici que d’un petit nombre des fonctions conférées aux lactifères thoraciques.
La première d’entre elles est le transport ou distribution du chyle [26] dans les veines axillaires ou subclavières. [27]
Leur deuxième fonction est la nutrition du corps, mais la raison pour laquelle elle repose entièrement sur l’insertion particulière des lactifères dans les subclavières est cachée dans l’obscurité de la nature. Les premières expressions des phénomènes nouveaux sont en effet modestes, tout comme leur interprétation, et rien de grand ne se révèle d’un coup. Toutefois, après que le très savant Riolan, qui est vraiment le prince dans l’exploration des fonctions anatomiques, en aura ouvert les portes, il deviendra plus facile et rapide de progresser sur la route qui permet de conjecturer sur ce qui nous intéresse. On peut croire, à ce qu’il en dit dans les omissions de son Manuel, page 298, [15][28][29] que le chyle est dérivé vers le confluent cave supérieur [30] afin que le sang qui y reflue depuis le cerveau et les membres supérieurs, lequel a été appauvri par la perte des esprits [31] qui se sont dispersés en tous sens, [Page 233 | LAT | IMG] soit restauré par l’apport nouveau d’un chyle parfaitement pur, puis, en circulant à travers le cœur, s’enrichisse en esprits régénérés. Ceux que le chyle, après une longue digestion, mêle ainsi au sang sont attirés et fermentent plus richement et commodément dans le cœur, comme font bien voir les chimistes avec leurs distillations. [32] Ainsi le cœur, qui est la source de la chaleur innée, [33] s’imprègne-t-il très facilement d’une rosée perpétuelle, qui l’empêche de se dessécher peu à peu. Ainsi aussi le sang y est-il moins susceptible de s’enflammer et échauffer contre nature, puisque s’y dilue deux ou trois fois par jour la portion du chyle qui l’humecte. Les lactifères thoraciques contribuent donc admirablement à la fonction circulatoire car, grâce à eux, le sang s’enrichit en esprits qui le rendent plus vaillant, et pénètre plus aisément dans les poumons avant de retourner dans le ventricule gauche du cœur. [34] Qui plus est, le sang sort mieux préparé des poumons qu’il a alimentés, en raison du mélange précis de bile [35] et aussi de pituite [36] que lui a délivré le chyle qu’il vient de recevoir : ayant un tempérament chaud, les poumons exigent en effet, pour modérer leur chaleur, d’être nourris par un sang bilieux ; et parce qu’ils sont animés d’un mouvement incessant, ils ont besoin d’une certaine quantité de pituite déliée pour éviter leur prompt échauffement et embrasement ; et quand les poumons sont malades, ils préparent ou transfèrent mal le sang et s’engorgent de pituite et de crachats, comme je l’ai dit dans le chapitre précédent. [16][37][38]
La plupart des plus doctes médecins ont peiné à admettre la formation de la graisse dans le cœur, en se demandant comment elle ne s’y liquéfie pas sous l’effet de la très intense chaleur qui y règne ; mais le chyle, dont on a découvert qu’il y pénètre, peut empêcher cela et procurer une matière propice à la production de cette graisse. [39]
En outre, en raison de ladite arrivée de chyle, le cerveau semble tirer du cœur par les carotides [40] quelque aliment qui lui convient et dont il a besoin, comme je l’ai dit dans le chapitre précédent. [41] Le cerveau est en effet, [Page 234 | LAT | IMG] selon Hippocrate, dans son Livre des Chairs, μητροπολις του ψυχρου και του κολλοδεος, « le siège du froid et du glutineux » ; [17][42] mais le principe de l’humeur glutineuse [43] est dans le chyle, qui contient une certaine mucosité, d’abord chaude, qui est située dans l’estomac [44] et qui est plus haut extraite des aliments grâce à quelque dissolvant humide.
J’en viens à la troisième fonction ou utilité des lactifères thoraciques, celle qui jette sur eux un éclairage de considérable importance. Primo, ils autorisent à comprendre la sympathie [45] qui existe entre l’estomac et le cœur, car ils établissent un chemin libre et ouvert qui permet aux deux viscères de communiquer librement entre eux, avec des conséquences tant heureuses que funestes car, comme l’ont déjà savamment remarqué Guiffart et Bartholin, [46][47] la puissance brute des remèdes cardiaques [48] et des poisons se transmet par leur intermédiaire. [18][49] Secundo, se font jour les causes jusqu’ici ignorées et inconnues de nombreuses maladies, pour m’exprimer comme Riolan dans sa résolution des Dubia anatomica de Bartholin, page 71. [19][50][51] Il écrit aussi dans les omissions de sa Responsio ad Experimenta nova anatomica, page 369, « Il faut remarquer la sympathie admirable du mésentère avec le cou, les aisselles et les mamelles, par le moyen de ces nouveaux canaux lactés ; et le vice des glandes scrofuleuses [52] ne paraît par ordinairement en ces lieux-là sans s’être enraciné dans le mésentère » ; [20] et dans son Iudicium de venis lacteis, etc. « Si ces veines lactées mésentériques sont fort lâches » (en raison de l’inconvénient que représente un réservoir [53] placé entre les psoas) « le sérum du chyle où le chyle lui-même peut se purger par les voies urinaires [54] ou par l’utérus, [55] ce qui provoquera d’opiniâtres pertes blanches utérines [56] et très difficiles à soigner qu’on attribuera, bien qu’elles soient dénuées d’acrimonie et d’inflammation, soit à une simple gonorrhée, [57] soit à des humeurs pituiteuses émanant de tout le corps et s’écoulant vers l’utérus » ; [21] et au-dessous, « Si on observe une humeur puriforme dans les déjections sans aucune douleur colique [Page 235 | LAT | IMG] préalable ni fièvre, la cause doit en être attribuée à l’écoulement de ce chyle lacté putréfié qui a régurgité dans les intestins. [58] Si sont émises des urines blanches ou si elles présentent un sédiment laiteux puriforme, sans aucune douleur préalable de l’abdomen ou des reins, ni aucune suspicion d’ulcère dans ces parties, il est permis de penser qu’il s’agit de chyle lactescent qui s’est épanché dans les veines rénales » [22] Selon Guiffart, il arrive même que du chyle répandu dans le thorax soit confondu avec du pus, [59] et Riolan l’a loué pour cette observation, comme je l’ai dit dans le chapitre précédent. [23][60] Il poursuit sur cette voie dans son Judicium de venis lacteis, page 29 : « Si le sang que vous avez tiré par la phlébotémie a un aspect laiteux, [61] n’allez pas penser que cette anomalie est toujours la conséquence d’une importante putréfaction qui siège dans le foie, mais bien plutôt qu’il s’agit de ce chyle qui s’est égaré dans les veines du bras ou du pied, ou qui a fini par y être attiré en raison de saignées trop copieuses. » Dans toutes ces citations, Riolan se réfère aux fonctions de lactifères qu’il a dits imaginaires dans ce même Judicium, page 7, ligne 6 : « Les fonctions de l’homme ne resplendissent pas plus nettement quand on y introduit ces lactifères imaginaires. [24] Aux pages 188‑189 de sa Responsio ad Experimenta nova anatomica, il parle encore ainsi du sang : « la couche de matière blanchâtre qu’on voit dans la poêlette de phlébotomie, épaisse d’un petit doigt, ne vient pas de la pourriture du sang, mais de cette partie du chyle qui surnage après être sortie avec le sang. » [25] Toutefois, puisque cela s’observe surtout lors du rhumatisme, [62] où le foie et les autres viscères nutritifs sont en effervescence et où, la plupart du temps, le corps entier est consumé par la fièvre, il est vraisemblable que la surface du sang se colore ainsi, formant une pellicule qui ressemble tout à fait à de la crème, sous l’effet de la chaleur qui en épaissit une partie, à la manière dont le feu épaissit la surface de la bouillie ; et Riolan ajoute aux pages 29‑30 de son Iudicium de venis lacteis, « je ne conteste pas que cela résulte de la corruption du sang dans les fièvres malignes ». Il semble en vérité que ces fièvres proviennent plutôt d’une putréfaction particulière, insolite et profonde du chyle qui s’est corrompu dans le réservoir [63] et dans les lactifères thoraciques. Sachant tout cela, on peut leur trouver une nouvelle fonction : le sang qu’on tire le plus souvent dans les fièvres est louable, tant par sa couleur que par sa [Page 236 | LAT | IMG] consistance ; seul y est visiblement corrompu le sérum [64] qui surnage, dont la teinte est sombre ou laiteuse, tandis que les urines ne diffèrent pas de celles des gens en bonne santé et que, pendant les premiers jours, les matières fécales conservent presque leur apparence naturelle ; ainsi est-il assez clair que le foyer des fièvres malignes ne se cache pas dans les voies ni dans les veines de son ressort, mais dans d’autres parties qui ne dépendent pas de lui. Tel est le réservoir du chyle, à partir duquel, en raison de sa susdite sympathie avec la veine cave supérieure, une émanation malfaisante s’exhale sans relâche en direction du cœur, laquelle aussi fait s’écouler goutte à goutte dans les subclavières un sérum lacté qui est l’émanation d’un chyle extrêmement putride et ardent ; et c’est lui qui ensuite, en nageant dans le sang, corrompt et ruine les forces directrices et les principales parties du corps, et tout particulièrement le cerveau.
J’ai décrit une autre fonction des lactifères thoraciques dans le précédent chapitre quand j’ai parlé de la matière qui engendre une abondance de crachats en se répandant dans les poumons au cours des affections rhumatiques. [16] Quand existe une mauvaise disposition et une cachexie des viscères, la matière contenue dans ces voies se transmet aisément aux poumons, car le réservoir du chyle et les lactifères sont entraînés dans l’effondrement de l’économie naturelle. On comprend aussi de manière nouvelle pourquoi, dans la fièvre tabide, [65] le frisson et les autres symptômes saisissent les malades après la prise de nourriture : le cœur, dont la chaleur est languissante, ressent l’affluence du chyle fort cru et séreux qui le refroidit plus encore, de sorte que son exhalaison attaque la membrane charnue qui revêt la totalité du corps. [66] Chez les gens en parfaite santé, au contraire, la nourriture produit un léger rafraîchissement qui indique que les lactifères thoraciques sont ouverts et libres, que les vapeurs aqueuses qui émanent en premier de l’aliment s’envolent aisément dans le thorax, puis dans tout le corps, et que [Page 237 | LAT | IMG] le libre cours des lactifères garantit le bon transport du chyle, lequel promet une prompte nutrition et une belle santé.
Il m’est impossible d’aller plus loin sur l’utilité des lactifères thoraciques. Dans le chapitre xiii de Lacteis thoracicis, [67] un commentaire de Bartholin a audacieusement amoindri le miracle du lait qui s’est écoulé quand le glaive a frappé le cou de saint Paul : « Si cette histoire est vraie, dit-il, nous avons trouvé sans peine le passage et le moyen qui l’expliquent. Les branches axillaires ou plutôt les insertions des canaux thoraciques dans ces veines se sont dilatées » ; et il ajoute que « le saint homme, qui avait été affaibli par une longue captivité, de nombreux voyages et les maladies qu’il avait endurées, avait amassé une abondance de sang séreux et de chyle ». [26][68] Quand on a tranché le cou, si du sang a coulé de la plaie, il est impossible qu’un élargissement de l’insertion axillaire des lactifères ait été la cause de ce prodigieux épanchement, car elle ne peut se dilater au point de dépasser le calibre de la veine cave supérieure, qui contient une énorme quantité de sang, laquelle absorbe immédiatement le chyle qui s’y écoule doucement, goutte à goutte, et devient rouge car il se transforme presque en sang, comme je l’ai montré au chapitre iv de mon traité. [27] Chez les animaux qu’on a bien nourris et qui sont pleins de suc, quand on pose un lien très serré sur les canaux thoraciques, puis incise le réservoir ou les lactifères remplis de chyle, il ne jaillit pas en torrents comme fait le sang hors de veines, mais s’égoutte lentement. [69] En outre, même après avoir gavé l’animal tant qu’on a pu, jamais on n’a vu du lait s’écouler de son cou quand on le lui a coupé. Il est juste de croire qu’il est produit beaucoup moins de chyle chez ceux qui ont enduré captivité, voyages et maladies, car tout cela tend plutôt à diminuer, voire à abolir la faim qui détermine l’abondance du chyle ; et par conséquent, il arrive parfois que les lactifères thoraciques ne soient pas visibles quand on dissèque les animaux. J’ajoute que le sang séreux n’est pas du chyle, et les yeux ne peuvent s’y tromper en le confondant avec du lait, [Page 238 | LAT | IMG] même quand sa couleur est altérée. Le plus insigne des poètes a chanté les animaux épuisés par la maladie qu’on sacrifie aux dieux : [70]
Aut si quam ferro mactaverat ante Sacerdos,
Inde neque impositis ardent altaria fibris ;
Ac vix suppositis tinguntur sanguine cultri,
Summaque jejunâ sanie infuscatur arena. [28][71][72]Bartholin aurait mieux fait de croire les témoignages de saint Ambroise et saint Chrysostome, éblouissantes lumières de l’Église, plutôt que se mêler de questions sacrées en inventant des arguties indignes d’un éminent anatomiste. [29][73][74] Dans la même idée, Riolan, au chapitre vii, livre iii de son Anthropographie, a dit : « C’est avec ignorance, sans parler d’impiété, que Du Laurens [75] a écrit que le liquide issu du flanc de notre Sauveur provenait du péricarde ; cela est miraculeux et contraire aux lois de la nature, étant donné que, durant la vie, il contient peu de liquide » ; [30][76] il est pareillement impossible de trouver du chyle laiteux dans une veine axillaire tant que le sang ne s’en est pas entièrement vidé car, comme j’ai remarqué plusieurs fois, le peu de chyle qui s’y écoule par les minces orifices des lactifères, à la manière d’une rosée, rougit dès qu’il se mélange au sang.
De toutes les fonctions des lactifères thoraciques que j’ai citées dans le présent chapitre, notamment de celles que j’ai tirées de Riolan, il est permis de conclure que la découverte pecquétienne n’est pas stérile, mais qu’elle contribue remarquablement au savoir médical, ainsi qu’à la connaissance et au traitement des maladies. Elle est fort éloignée de semer, si peu que ce soit, la perturbation ou de rendre nécessaire la création d’une médecine nouvelle, comme l’objecte Riolan aux pages 150 et 154 de sa Responsio, et plus disertement à sa page 176, où il dit que « par sa doctrine nouvelle et inouïe, Pecquet a contribué à bouleverser la structure du corps humain, et renverser entièrement la médecine ancienne et moderne ». [31][77] Tout le monde prétendait initialement que la circulation du sang changeait la méthode pour remédier, et Riolan lui a [Page 239 | LAT | IMG] brillamment opposé cette crainte dans une savante thèse quodlibétaire qu’il a soumise aux Écoles et qu’on lit à la page 543 de son Anthropographia, dans le Liber de Circulatione sanguinis. [32][78][79] Il me sera donc maintenant très facile de mettre les lactifères thoraciques à l’abri de la même imposture. En résolvant le premier argument dans le précédent chapitre, j’ai montré que les veines mésaraïques [80] ordinaires apportent presque une moitié du chyle au foie, [33][81] qui le transforme en sang et le purge de son excrément bilieux. [82][83] Cette distribution partagée du chyle est parfaitement compatible avec les canaux pecquétiens et les vaisseaux lymphatiques de Bartholin, [84] sans avoir à envisager les funérailles du foie ni à le mener au tombeau, tout vif et couronné qu’il est. Évoquant ceux qui se sont levés de leur cercueil et réveillés sur le bûcher funèbre, Pline, livre vii, chapitre lii dit : Hæc est conditio mortalium, ad has et ejusmodi occasiones fortunæ gignimur uti de homine ne morti quidem debeat credi. [34][85] Ainsi, mon très cher Iatrophile, une fois chassés les soupçons de jalousie et de sédition qui animeraient les pecquétiens, la mort épargne-t-elle le foie : il surgira de son tombeau et vivra pour jouir de son trône pendant encore quantité de siècles !
Absint inani funere næniæ,
Luctusque turpes, et querimoniæ ;
Compesce clamorem, ac sepulcri
Mitte supervacuos honores. [35][86]Jamais le principal et premier viscère de l’économie naturelle ne sera dessaisi du droit et pouvoir de fabriquer le sang, il sera toujours le siège de cette faculté vitale, toujours l’officine de la sanguification à qui le foie permet de demeurer saine et sauve, mais qui est lésée dès qu’il est malade. Le foie en bonne santé est la source d’une favorable émanation, d’une humidité qui baigne les parties d’une humeur salutaire, et leur procure splendeur et belle couleur ; Gelidum verò fundit aquas rosei vice sanguinis, [36][87][88] en sorte qu’à l’ordre du [Page 240 | LAT | IMG] foie répond véritablement l’état de tout le corps. Ces constats prouvent très manifestement que dans le foie s’épanouit une certaine impulsion, qui s’en écoule partout dans le corps pour lui procurer sa force, et qu’il est, en lui-même et en premier lieu, utile à la conservation de la vie ; et ni les canaux pecquétiens ni les vaisseaux lymphatiques ne peuvent démolir cela.
Bartholin, dans le chapitre xv de son livre de lacteis thoracicis, [89] a écrit qu’« à eux seuls, les lactifères thoraciques ne sont pas suffisants pour transporter la totalité du chyle », et ses vaisseaux lymphatiques ne peuvent augmenter la capacité des canaux thoraciques. En témoigne encore une lettre du très savant Conring : [90] « Il est parfaitement impossible que tout le chyle s’écoule par le canal que Pecquet a découvert. La nature semble pourtant avoir certainement été mieux avisée en lui permettant de se mélanger au sang veineux en divers et multiples endroits, plutôt que d’être entièrement élaboré en un seul endroit au même moment. » [37][91][92] Riolan est pourtant mal inspiré de penser que l’insertion de lactifères dans les subclavières a ôté sa couronne au foie, car il juge aussi qu’ils s’insèrent dans une autre veine, à savoir la cave inférieure. [93] La question principale n’est pas l’insertion des lactifères, mais l’endroit où se forme un sang parfait : les particules de chyle mélangées au sang qui se glisse dans le foie subissent une modification particulière dans son parenchyme et s’y transforment en un sang imparfait, tout en s’y purgeant de leurs excréments bilieux ; après s’être formées dans les intestins, qu’elles passent par les veines mésaraïques ordinaires ou par les lactifères thoraciques pour gagner la veine cave supérieure puis le cœur, la circulation finit toujours par les faire aller dans le foie. C’est en effet lui qui est l’autre source de la chaleur innée parce que le riche fonds de son vaste et épais parenchyme renferme une très grande quantité d’esprits naturels ; [94] en outre, les innombrables veines qui y sont éparpillées contiennent beaucoup de sang, dont [Page 241 | LAT | IMG] les particules, épaissies et comprimées par tant de chenaux étroits et de pores, [95] permettent une multiplication de la chaleur qui aide admirablement la digestion accomplie par l’estomac, sorte de grande marmite posée sur un feu qui l’entoure de tous côtés.
C’est surtout ici qu’on se convainc que la filtration n’est pas une fonction exclusive du foie et que la portion du chyle qui parvient séparément dans les subclavières n’échappe pas à cette modification, mais la subit autrement. [96] Riolan est forcé, bien malgré lui, me semble-t-il, d’en convenir, car il a vu ce chyle se mêler au sang à proximité du cœur, il enseigne que ce sang, suivant la circulation qu’il professe, passe sans délai des subclavières et de la veine cave dans le cœur, et il avoue que le sang du cœur est plus pur que celui du foie et que, selon la sentence des péripatéticiens, [97] c’est dans le cœur que le sang subit une nouvelle coction pour devenir vital en acquérant sa vertu nutritive et sa chaleur. [38][98] Il reconnaît en outre que le sang est purgé de ses excréments bilieux dans le foie en passant de la veine porte à la veine cave, [99] avant de remonter vers le cœur. Ne faut-il pas nécessairement conclure de tout cela, conformément à l’aveu que j’ai arraché dans Riolan, que le sang chyleux, puisqu’il n’est pas absolument pur, n’acquiert pas sur-le-champ sa perfection dans le cœur, mais en passant successivement dans les deux viscères et en y étant préparé par des maintes traversées itératives : digéré et purgé dans le foie, il est enfin achevé dans le palais du cœur. Si nous croyons Aristote et ses sectateurs, dit Riolan au chapitre iii de son livre sur la circulation du sang conformément à la doctrine d’Hippocrate : [100] « Tout le sang qui est préparé dans le foie doit y parvenir, pour qu’il acquière sa perfection. Le sang produit par le foie est en effet fort grossier et inachevé, ce qui tient à sa matière ; celui qu’élabore le cœur est plus achevé, ce qui tient à sa forme, d’après Averroès. [101 Galien lui-même, livre vi de placitis, [102] chapitre x, conclut sa longue discussion contre Érasistrate [103] en convenant qu’aucune opération importante [Page 242 | LAT | IMG] et achevée ne s’accomplit subitement et en un seul assaut, et n’atteint pas sa perfection dans un seul organe. » [39]
Qu’y a-t-il donc de scandaleux dans cette sentence, et en quoi les lactifères thoraciques modifient-ils la médecine et le traitement des maladies ? Toutes se localisent en effet dans le foie, selon Riolan, à la page 176 de sa Responsio, [32] et celles qui sont dues « à son action lésée, à savoir lorsque l’attraction ou rétention du chyle est diminuée ou abolie, ou que la sanguification ne se fait pas, telles que sont la diarrhée chyleuse, la diarrhée hépatique, [104] la cachexie, l’atrophie, [105] l’hydropisie », dépendront encore du foie. Certaines dépendront cependant aussi des lactifères nouvellement découverts, mais non pas « du cœur et des poumons » comme écrit Riolan au même endroit, car les excréments du sang et du chyle ne se collectent et séparent que dans l’abdomen, et non dans ces deux viscères. [106][107] On devra donc encore prendre le foie en considération dans le traitement de ces maladies, et c’est vers lui que devront être dirigés les remèdes. Ainsi n’est-il pas nécessaire de concevoir une nouvelle méthode, et ne fait-on qu’ajouter de la lumière à la médecine antique et hippocratique. Puisque le foie demeure l’officine de la sanguification, ce n’est pas en vain qu’on travaillera à le rectifier et purger ; ce n’est pas en vain qu’on l’accuse d’être l’auteur de l’hydropisie par défaillance de la sanguification ; ce n’est pas en vain qu’on prescrit des remèdes quand un excès de sang afflue vers le foie ; [108] ce n’est pas en vain qu’Hippocrate, Aristote et Arétée [40][109] ont attribué au bon fonctionnement ou à la défaillance hépatique la saine ou la mauvaise constitution de tout le corps. En revanche, c’est en vain et à tort que Riolan mettrait tout cela sur le dos des lactifères thoraciques. Les médecins ne se fourvoient pas et ne trompent pas tous les jours leurs malades quand ils attribuent l’origine et le fondement de presque toutes les maladies à des obstructions du foie, de la rate, du mésentère, du pancréas, [Page 243 | LAT | IMG] et quand ils dirigent leurs traitements vers les parties en cause. Riolan s’est pourtant encore fourvoyé en pensant que les défenseurs des canaux pecquétiens n’étaient pas de même avis que lui, car ils concluent que du chyle pénètre dans le foie, et reconnaissent les mêmes facultés et fonctions hépatiques que Riolan, et les mêmes causes aux affections susdites.
En conclusion, je pense que mes cinq chapitres ont anéanti la Responsio de Riolan aux Experimenta nova de Pecquet. Pour la vérité sur les lactifères thoraciques, moi qui ne suis qu’un pauvre petit homme de piètre instruction et inconnu des savants, face au plus célèbre des anatomistes, « j’ai résisté parce qu’il s’était mis en tort ». [41][110] Ainsi un méprisable petit poisson peut-il parfois ralentir un grand navire chargé de victoires, [42][111] et la vérité se défend-elle d’elle-même, et non pas seulement en s’appuyant sur les titres de gloire, sur le prestige des origines, ou sur le renom personnel. Pour plaider la cause des lactifères thoraciques, j’ai donc recouru à Dieu et à la nature, sans châtier l’outrage par l’outrage, car comment peut-on mieux nuire à une très juste cause ? J’y ai observé le respect qui est dû au plus éminent des anatomistes et, plus encore, à la vérité. Si ont été tenus de trop rudes propos, je voudrais qu’ils ne l’aient pas été, mais ce n’est pas de moi qu’il les a entendus, mais de lui-même, car c’est de ses mots et ses phrases qu’il a construit les muscles et les articulations de sa propre ruine, et non ex aliis tractatibus in quos inquiri non vult, comme il dit dans ses omissions contre Schlegel, [112] page 370. [43][113] J’ai tiré mes citations des derniers opuscules de Riolan, et surtout de sa Responsio ad Experimenta nova, sans les contracter essentialia omittens, comme il en a fait grief à Bartholin, à la page 75 de la résolution de ses Dubia anatomica ; [44] et si j’ai quand même [Page 244 | LAT | IMG] retranché quelques trop rudes propos, dans l’ardeur involontaire du débat et contraint de me défendre, je prie ce très magnanime personnage de bien vouloir m’en pardonner. Être dénué de tout défaut dépasse néanmoins le sort de l’humaine félicité, et j’atteste et avoue, honnêtement et amicalement, en avoir montré certains en cédant à la démangeaison de blâmer Riolan, et surtout de le contredire et de médire de lui ; ce que je n’ai pas fait pour rabaisser un brillant homme que j’aime et respecte, mais pour l’aider à prendre en horreur ses injures et à s’en abstenir enfin. Filius potest erroris admonere patrem et à sententia ejus recedere, livre iii, § si quis ff. de condictio. caus. dat. In publicis functionibus præcedit utilitas patriæ : quia primùm reipublicæ nascimur deinde parentibus et propinquis, livre i § generaliter. ff. de vent. in possess. mittend. [45][114] Hoc ab homine exigitur, ut prosit hominibus si fieri potest multis, si minùs paucis, si minùs proximis, si minùs sibi, dit Sénèque au chapitre xxx du Repos du sage. [46] Cet avis est celui qui doit nous pousser à écrire, et non la loi d’Adrastée, [115] dont pourtant Riolan menace inutilement les partisans de la découverte pecquétienne, alors que lui-même porte Némésis sur son dos, selon la célèbre réplique que fit Léon de Byzance à un bossu qui s’était moqué de sa mauvaise vue. [47][116][117][118] Si je me suis glissé dans l’arène, c’est afin de lutter pour la vérité, car je sais et pense, aussi bien que n’importe qui d’autre, être exposé à l’erreur, et trouverai glorieux que quelqu’un m’en corrige. Viros suspice, dit Sénèque, etiam si decidunt, magna conantes. [48][119] Se tromper est le propre de l’homme, celui du chrétien est de haïr l’erreur et d’aimer celui qui critique celle qu’il a commise. Puissions-nous tenir nos esprits vraiment à l’écart de toute malveillance, et avoir le bonheur de nous réjouir que ce siècle ait heureusement accompli cet oracle ! [Page 245 | LAT | IMG]
Flumina tunc lactis, tunc flumina nectaris ibunt. [49][120]Puisse dorénavant Riolan être plus constant en ses jugements ! Puisse-t-il ne plus batailler contre les expériences les plus probantes ! Puisse-t-il s’abstenir d’insulter, et de n’être que fiel et amertume à l’encontre des anatomistes qu’il appelle lactés ! [50] Puisse-t-il, quand il écrit, observer la modestie dont il chante les louanges, savoir que cela est juste et beau, et ne pas faire ce qu’il reproche à Schlegel, page 226 : Carpere mordaciter, atque irredere quasi stultum aliquid, quod dogmatice in controversiam venerit, id procacis atque petulantis hominis est ! [51] Nous vanterons néanmoins les qualités du très savant Riolan car elles sont remarquables et accordées à peu de gens. Nous louerons sa très féconde mémoire, qui a engrangé une si riche moisson de mots et de faits ; son omniscience admirable ; son immense connaissance de l’art médical et de l’anatomie, fondée sur l’expérience, et affermie par une très longue pratique, et par la lecture attentive et très approfondie de tous les auteurs de qualité, tant anciens que modernes, jointe à de soigneuses et fréquentes dissections des cadavres humains ; les citations des poètes et des prosateurs, qui sont autant de resplendissantes gemmes dont il illustre partout ses ouvrages ; et encore son indéfectible ardeur à étudier et à écrire, en dépit de son grand âge, et nous prions Dieu qu’il continue de vivre heureux et d’être utile au progrès du savoir anatomique. Enfin, tant que nous vivrons ici-bas, nous aimerons toujours, comme nous l’avons fait jusqu’ici, le nom de Riolan qui brille dans toutes les universités d’Europe, comme la parure des l’École médicale parisienne, qui est la régente des autres. Nous le vénérerons tout particulièrement pour sa grande Anthropographie car la vie des hommes [Page 246 | LAT | IMG] lui en est éminemment redevable ; en anatomie, elle est le digne guide du monde savant, dont la gloire volera longtemps et partout sur les lèvres des hommes ; qu’elle en jouisse aujourd’hui que son auteur est en vie et, par anticipation, durant l’éternité qu’il aura bien méritée et à qui il a consacré cet immortel ouvrage empli d’érudition, qu’on ne vantera jamais suffisamment. [52]
[Fin]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |