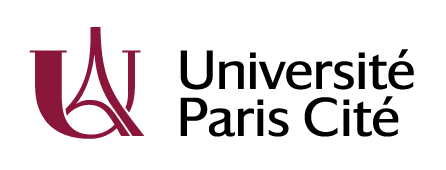< Jean ii Riolan
Responsiones duæ (1655),
Responsio ad Pecquetianos
5e de 6 parties >
Codes couleur
Citer cette lettre
Imprimer cette lettre
Imprimer cette lettre avec ses notes
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1058
(Consulté le 03/06/2024)
Page 229, « Il ne faut pas s’étonner qu’au début, tous n’aient pas cru [Page 128 | LAT | IMG] aux lactifères thoraciques [3] et qu’ils aient paru improbables à la foule ignorante ; mais il est étonnant que l’homme qui se dit le prince de la science n’ait pas encore été suffisamment pénétré par la force et la majesté de la nature pour admettre leur existence, parce qu’elle est nouvelle, Dira imprecatione, ut Atlantes orientem solem solebant, contuitum fuisse. » [4] Ce début de chapitre vient de Riolan, et vous appelez « foule ignorante » les savants hommes qui nient la fonction des veines lactées thoraciques, en les croyant semblables aux Atlantibus, qui Orienti Soli imprecabantur, mais laissez les Apharantes en paix ! [1][5] « Riolan a injurieusement attaqué la découverte de Pecquet, blâmant la mauvaise utilité qu’il lui a conférée », [6] et je soutiens encore que j’ai raison. Nerui sapientiæ sunt, nihil temere credere, disait Épicharme ; [7] Qui leuis est corde, facilè credit, et reprobabitur, disait l’Ecclésiastique ; [8] Difficile est dare verba Seni. [2][9]Page 230, « Quand Riolan avoue ingénument son ignorance, pourquoi veut-il que les jeunes soient plus sages que leur vieux maître ? » Je ne vous demande rien, ni à votre associé. [10] Vous avez pourtant proposé hardiment que le cœur produit le sang à partir du chyle, en affirmant qu’il en transforme la moitié la plus ténue en un sang parfaitement pur ; et vous ajoutez qu’« il nous est impossible de nier ou de mettre en doute l’existence des lactifères thoraciques, même si nous ignorons entièrement leur utilité et le dessein de leur insertion ». Ce que je n’admets pas, en effet, c’est la fonction que leur ont attribuée Pecquet et ses disciples.
Notre jeune collègue [11] m’invite à expliquer certains faits qu’il juge inextricables : « à quoi les nævus [12] qui s’épanouissent à la surface de la peau servent-ils ? à quelle fin y a-t-il des poils en certains endroits du corps ? à quoi les tétons servent-ils chez les hommes ? » Je lui réponds en un mot qu’il trouvera l’explication de ces faits sans [Page 129 | LAT | IMG] grand intérêt dans mon Anthropographie, [13] dont l’index lui montrera où trouver cela. Sur les nævus, qu’il lise la seconde édition du très savant et subtil livre de Ludovicus Septalius. [3][14]
Page 232, « Après que le très savant Riolan, qui est vraiment le prince dans l’exploration des fonctions anatomiques, en aura ouvert les portes », il vous permettra d’exposer cela à votre mode et votre idée : « le chyle est dérivé vers le confluent cave supérieur [15] (notez que vous appelez ascendante la veine cave supérieure afin que le lecteur comprenne que le sang monte vers les subclavières), [16] en sorte que le sang qui y reflue depuis le cerveau et les membres supérieurs, lequel a été appauvri (pour parler comme Riolan) par la perte des esprits [17] qui se sont dispersés en tous sens, soit restauré par l’apport nouveau d’un chyle parfaitement pur ; puis, en circulant à travers le cœur, s’enrichisse en esprits régénérés. » L’afflux de chyle dans le cœur restaurerait donc le sang (voilà qui est une fonction nouvelle de la circulation), puis reviendrait bientôt au cœur après avoir circulé et l’enrichirait en esprits frais. Cette seconde circulation suffirait alors pour que les esprits, « que le chyle, après la longue digestion qu’il a subie, a ainsi mêlés au sang, soient attirés et fermentent plus richement et commodément dans le cœur ». Une digestion prolongée du chyle aurait donc lieu dans le cœur, bien qu’il doive le traverser rapidement, dans le court espace de temps qui sépare la systole de la diastole. [18] Les lactifères thoraciques assisteraient admirablement la fonction de la circulation : le sang enrichi par les esprits traverserait plus facilement les poumons avant d’arriver dans le ventricule gauche. [19] Pecquet n’a pas conçu cette merveilleuse utilité du chyle qui parvient au cœur, mais c’est notre autre jeune anatomiste qui est « appauvri » en intelligence de cette science, car il ignore que le sang artériel circule nuit et jour, sans la moindre interruption [Page 130 | LAT | IMG] et il envoie en permanence et de tous côtés du sang nouveau et spiritueux qui assure la chaleur de tout le corps, nourrit ses parties et conserve leur vitalité ; il revient ensuite par les veines, pour fournir au cœur la matière qui lui permet d’accomplir ses actions, acquérant ainsi une chaleur nouvelle. Ce ferment du chyle, qui rend le sang plus vigoureux et vif, manquera pendant vingt heures par jour aux jeûneurs monosites, qui ne mangent qu’une fois par jour, ce qui rendra votre circulation imparfaite. [4]
Page 233, « Grâce à la même montée du chyle, le cerveau reçoit par les carotides [20] l’aliment qui lui convient et dont il a besoin » : le sang que les deux grosses carotides et quatre autres artères latérales et postérieures fournissent au cerveau doit être de la plus haute pureté pour engendrer les esprits animaux [21] et nourrir la matière cérébrale, dont la masse est quatre fois plus élevée que celle des bovins. La qualité de sa substance fait qu’il produit beaucoup d’excréments pituiteux [22] chez certains individus, mais peu chez d’autres, comme l’estomac n’en engendre qu’en proportion de sa substance membraneuse et des aliments qu’il reçoit ; ce qui a fait dire à Hippocrate que le cerveau et l’estomac sont les deux sièges de la pituite. [5]
Page 234, « La connaissance des lactifères thoraciques autorise à comprendre la sympathie [23] qui existe entre l’estomac et le cœur, car ils établissent un chemin libre et ouvert qui permet aux deux viscères de communiquer librement entre eux, avec des conséquences tant heureuses que funestes car, comme l’ont déjà savamment remarqué Guiffart et Bartholin, [24][25] la puissance brute des remèdes cardiaques [26] et des poisons se transmet par leur intermédiaire. » [6] Comment ces substances peuvent-elles librement gagner le cœur sans [Page 131 | LAT | IMG] passer par les intestins, les veines mésaraïques, [27] le réservoir [28] et les lactifères thoraciques ? Longues sont les sinuosités de ces voies, et les docteurs que vous citez n’ont pas énoncé qu’elles servaient à transmettre au cœur la puissance brute des poisons, car la nature serait mauvaise mère si elle leur avait conçu un emploi qui nuise à l’homme. Vous écrivez sans savoir pourquoi car vous ignorez l’anatomie, vous auriez été plus habile à coudre, teindre et façonner des gants, qui était le métier que vous avez abandonné pour vous consacrer à la médecine, à la manière des disciples de Thessalus. Ne sutor sapiat ultra crepidam, nec chirothecarius ultra chirothecam. [7][29][30][31]
Ce que dit Aristote au livre xiv de sa Métaphysique [32] contre les pythagoriciens [33] se disputant sur les nombres, cadre vraiment avec vos arguments et sophismes : Hæc omnia irrationabilia sunt, ac ipsa sibi ipsis et bene ratione utentibus compugnant ; videtur in eis esse longus Simonidis sermo, fit namque longus sermo, quemadmodum is, qui servorum est, cùm nihil sanum et rectum dicunt. [8][34]
Il est vrai qu’en spéculant sur les veines lactées, tant celles du thorax, qui montent jusqu’aux axillaires, que celles de l’abdomen, qui s’attachent au tronc de la veine cave, Riolan a compris les causes de maintes maladies que Pecquet et ses disciples ignoraient. Je conviens avoir qualifié les lactifères thoraciques d’imaginaires, mais une fois seulement, quand je les considérais sous l’angle de leur rôle dans la sanguification. [9]
Page 238, « Il est impossible de trouver du chyle laiteux dans une veine axillaire tant que le sang ne s’en est pas entièrement vidé car, comme j’ai remarqué plusieurs fois, le peu de chyle qui s’y écoule par les minces orifices des lactifères, à la manière d’une rosée, rougit dès qu’il se mélange au sang. » Pecquet et d’autres mentent donc quand [Page 132 | LAT | IMG] ils affirment que ce liquide laiteux descend vers le ventricule cardiaque droit [35] sans changer de couleur ; en outre, il ne peut entrer dans la veine axillaire sans être propulsé par la main de l’opérateur.
Le disciple de Pecquet en conclut que « la découverte pecquétienne n’est pas stérile, mais qu’elle contribue remarquablement au savoir médical, ainsi qu’à la connaissance et au traitement des maladies ». C’est à lui de le prouver en énumérant lesdites maladies. Pour ma part, j’ai cité plusieurs maux que provoquerait la sanguification cardiaque, et dont elle rendrait le développement et le traitement impossibles. Que nos pecquétiens sont donc savants en médecine pour ainsi connaître les maladies et leur guérison ! Vous n’avez pas osé vous y essayer, mais votre précepteur a été plus hardi en concevant et proposant une pathologie ridicule, inouïe et difficilement intelligible.
Page 239, vous vous trompez honteusement en déclarant que « les veines mésaraïques ordinaires apportent la moitié du chyle au foie, [36] ce qui est parfaitement compatible avec les canaux pecquétiens et les vaisseaux lymphatiques de Bartholin ». [37] C’est à vous de le prouver. Vous louez Bartholin pour ne pas l’irriter quand vous n’ôtez pas au foie sa primauté dans l’économie naturelle. [38]
Quo teneam vultus mutantem Prothea nodo ? [10][39][40]Vous accordez vos faveurs à Pecquet et chantez les louanges de cet inventeur et de sa découverte, tout en vous en éloignant ; vous désapprouvez le verdict de Bartholin sur ses funérailles du foie, [41] tout en faisant l’éloge de ses vaisseaux lymphatiques. Votre associé adhère plus solidement à votre maître, car lui a montré son ardeur pour la cause de Pecquet dans la seconde édition de son livre. [42]
[Page 133 | LAT | IMG] Pages 240‑241, il faut bien relever l’immense ignorance de notre docteur pecquétien en anatomie : il imagine que la circulation renvoie dans le foie la moitié du chyle qui a été transportée dans le cœur par les canaux thoraciques, pour qu’elle y soit purgée de sa bile, [43][44] et que cette portion du chyle qui s’est séparée pour atteindre les subclavières n’échappe pas à la puissante attraction hépatique ; et il s’efforce de prouver cela en s’appuyant sur diverses citations de Riolan qu’il a malicieusement déformées pour les mettre à son goût : « Je conclus de tout cela, conformément à l’aveu que j’ai arraché dans Riolan, que le sang chyleux hépatique, puisqu’il n’est pas absolument pur, n’acquiert pas sur-le-champ sa perfection dans le cœur, mais en passant successivement dans les deux viscères et en y étant préparé par des transfusions maintes fois répétées : digéré et purgé dans le foie, il est enfin achevé dans le palais du cœur. » Voilà une imposture manifeste, car il est bien incapable de le démontrer.
Je lui déclare que les voies qu’il désigne sont impossibles : le sang mêlé de chyle que le cœur a envoyé dans les extrémités du corps retourne très souvent au cœur en passant par le foie pour y être à nouveau digéré et devenir exactement semblable à l’autre sang, qui est hépatique. La circulation d’Harvey [45] ne tolère pas ce trajet car le sang une fois sorti du cœur puis recueilli dans la veine cave, regagne directement le cœur sans passer par le foie, hormis celui qui a reflué dans la veine porte après avoir nourri les parties alvines. [46]
Page 242, « Qu’y a-t-il donc de scandaleux dans cette sentence, et en quoi les lactifères thoraciques modifient-ils la médecine et le traitement des maladies ? » Selon la doctrine de Pecquet, ces lactifères renversent notre médecine, fondée sur Hippocrate et Galien, [47][48] car l’économie naturelle s’en trouve complètement bouleversée : [Page 134 | LAT | IMG] le foie n’engendrant plus le sang, il n’y aura plus ni faculté naturelle ni esprits naturels, [49] qui fournissent leur substance aux esprits cardiaques vitaux ; les autres parties nutritives ne seront plus sous la dépendance du foie, non plus que la rate, les reins, les parties génitales, car il existe une coopération entre leurs principes et ce qui dépend d’eux, sous condition d’un abondant écoulement du sang. La conjonction du foie et des veines, qu’Hippocrate et Galien ont tant célébrée, sera ridiculisée. Si le cœur produit seul le sang, il ne faudra plus appliquer de ventouses [50] près du foie, comme préconise la doctrine d’Hippocrate, ni renforcer le foie quand il est affaibli, ni prendre soin de le rafraîchir ou réchauffer pour le revigorer en cas d’hydropisie. [51] Les anomalies du sang dépendront de sa formation primitive dans le cœur, mais non de son parcours dans les artères et les veines. Notre jeune docteur estime que la distinction d’un chyle épais et ténu, ou hépatique et cardiaque, préserve l’intégrité de notre art, et même qu’elle éclaire grandement la circulation harvéenne du sang. Ainsi se dispense-t-il d’expliquer les maladies que Riolan a énumérées. [11]
Page 243, « Riolan s’est fourvoyé en pensant que les défenseurs des canaux pecquétiens n’étaient pas de même avis que lui, ils concluent pourtant que du chyle pénètre dans le foie, et reconnaissent les mêmes facultés et fonctions hépatiques que lui. » Vous mentez effrontément car, dans la seconde édition de sa lettre, votre associé a confirmé la sentence de Pecquet, comme vous avez fait dans celle de la vôtre : [52] l’unité du principe a convaincu [Page 135 | LAT | IMG] Aristote que le cœur est l’organe premier de la sanguification. [12][53]
Page 243, vous tirez maintenant gloire d’avoir « anéanti la Responsio de Riolan aux Experimenta nova de Pecquet », en ajoutant : « Pour la vérité sur les lactifères thoraciques, moi qui ne suis qu’un pauvre petit homme de piètre instruction et inconnu des savants, face au plus célèbre des anatomistes, “ j’ai résisté parce qu’il s’était mis en tort ”. » [54] Exegit monimentum ære perennius, [13][55] tout en poursuivant Riolan de ses turpitudes, calomnies et sophismes, lui que nul à ce jour n’a jugé digne d’être blâmé, mais qu’on a, au contraire, couvert d’honneurs qu’il n’a pas mendiés, dont on a loué les livres et qu’on a remercié pour ses épuisants travaux anatomiques. Vous dites avec vérité que vous auriez été « inconnu des savants » si vous n’aviez ainsi médit de moi : Egregiam verò laudem et spolia ampla refertis Tuque tuúsque socius, dum argutos inter strepere anser olores voluisti. [14][56][57]
Vous supposez malicieusement que « de mes mots et mes phrases j’ai construit les muscles et les articulations de ma propre ruine », mais c’est parce que vous les avez compris et repris de travers : nihil est quod malè narrando non possit deprauarier. [15] Vous prétendez avoir suivi mes derniers Opuscules, [58] mais vous y avez laissé de côté mon Jugement nouveau, [16] où je soutiens et maintiens que je laisse le lecteur juge des autres fonctions des lactifères thoraciques, mais vous avez mutilé mon propos pour en altérer le sens.
Pages 244‑245, « J’atteste et avoue, honnêtement et amicalement, avoir cédé à la démangeaison que chacun éprouve de blâmer Riolan, et surtout de le contredire et de médire de lui, ce que j’ai fait pour rabaisser un brillant homme que j’aime et respecte, mais pour l’aider à prendre en horreur ses injures et à s’en abstenir enfin. Puisse dorénavant Riolan être plus constant en ses jugements ! Puisse-t-il ne plus batailler contre les expériences [Page 136 | LAT | IMG] les plus probantes ! Puisse-t-il s’abstenir d’insulter, et de n’être que fiel et amertume à l’encontre des anatomistes qu’il appelle lactés ! Puisse-t-il, quand il écrit, observer la modestie dont il chante les louanges ! »
Tam felix vtinam, quàm pectore candidus essem,
Extat adhuc nemo saucius ore meo. [17][59]Vous ignorez que les écrits des vieillards sont des chants du cygne parce qu’ils s’expriment avec plus de douceur : l’âge ayant fait mûrir leur plume, leurs mots sont mielleux, sans amertume.
De quel droit accusez-vous déloyalement et honteusement Riolan ? La Faculté vous a-t-elle conféré le pouvoir de blâmer son plus ancien maître, [60] cui chorus assurexerit omnis. [18] À l’exemple de son père, [61] il fut un excellent et fidèle collègue ; gloire de la Faculté, il l’a noblement défendue contre ses adversaires ; aussi a-t-elle prononcé un décret solennel célébrant la gloire de Riolan le père et de sa descendance, qui est transcrit à la fin de la Libavimania. [19][62] Nulli patientiùs reprehenduntur, quàm qui maximè laudari merentur, dit Pline, dans la lettre xx, livre vii ; [20][63] mais nul anatomiste sensé ne supportera docilement d’être déloyalement et très injustement blâmé par qui n’a absolument aucune expérience de cette science et n’y connaît absolument rien.
An si quis atro dente me petiuerit,
inultus vt flebo puer ? [21][64]On n’a encore trouvé personne qui ait reproché à Riolan sa « démangeaison de blâmer », mais tout le monde l’a loué pour avoir publié des animadversions contre les anatomistes, et lui-même a depuis longtemps souhaité que d’autres le corrigent avec modération vt superesset artifici regressus ad veniam et emendationem. [22][65] Bartholin n’a pas dédaigné [Page 137 | LAT | IMG] mes animadversions pour corriger la troisième édition de son Anatomia reformata, [66] bien que Riolan ait malmené son renom ; [23] et si les anatomistes qui nous ont précédés revenaient de l’au-delà, ils corrigeraient leurs ouvrages en puisant dans mes animadversions.
Dites-moi pourtant, je vous prie, que trouvez-vous de rude et d’arrogant dans ce titre d’Animadversions ? Quand il enseigne publiquement au Collège royal de Cambrai, [67] devant un grand cercle d’auditeurs, notre collègue Guy Patin [68] commente mon Manuel anatomique et pathologique, [69] et a donné à ses leçons le titre d’Animadversions, comme son programme l’affiche publiquement, sans que je m’en trouve offensé. [24] L’éminent savant Joseph Scaliger a procédé de la même façon quand il a publié, sous le nom d’Yvo Villiomarus, un livre d’animadversions, tout plein de très riche érudition, sur des passages controversés de l’Italien Robertus Titius, [25][70][71] ce dont on n’a jamais entendu personne se plaindre. Sachez donc bien qu’en raison de mon ancienneté et prééminence parmi les médecins, je suis le censeur perpétuel de la Faculté de médecine quand la question porte sur la doctrine médicale et principalement sur l’anatomie, et j’agis aussi là en qualité de professeur d’anatomie, désigné par l’autorité royale, afin que cette science demeure pure et intacte, et surtout que d’ignorants novateurs, tout comme de vieux renards, devrais-je dire, ne fassent subir aucun dommage à notre république médicale. [26][72]
En outre, en raison de l’âge avancé que j’ai atteint par la singulière grâce de Dieu, et en raison de la modeste compétence que j’ai acquise en médecine après cinquante-cinq années de pratique, grâce [Page 138 | LAT | IMG] au labeur opiniâtre et à l’inlassable application que j’ai déployés et cultivés, je suis le zélateur de la vérité, ce qui me donne le droit de sévir contre ceux qui se fourvoient en médecine. Il est donc malhonnête et honteux que vous déchiriez Riolan et l’accabliez de vos injures et de vos outrages. Vous avez fait cela pour vous gagner quelque renom, mais après vous être marié et avoir acheté une mule que vous promenez orgueilleusement dans Paris, vous voilà vraiment devenu mulo-medicus. [27]
Il vous manquait un très éminent athlète à qui vous confronter, et vous l’avez trouvé en la personne de Riolan, que vous couvrez de coups de poing et de crachats, puis que vous saluez respectueusement d’un Ave Rabbi, [28][73] et chantez merveilleusement ses louanges. Est-ce là autre chose que me trahir perfidement puis obtenir le pardon de vos injures, afin que tant de crimes ne soient imputés à votre vénérable dignité janséniste, que le souverain pontife Innocent x a condamnée ? [29][74][75]
Si vous étiez encore capable de honte, vous devriez rougir pour cette Apologie pecquétienne, qui est entièrement fausse et parfaitement impudente, et en réclamer le salaire qui convient à votre renom et à votre labeur, plus grand encore que celui dont Pecquet a gratifié son Alethophilus. [76][77] Je vous retrouve bien dans l’épigramme xvii, livre viii, de Martial, sur l’avocat Sextus défendant une mauvaise cause :
Egi, Sexte, tuam, pactus duo millia, causam,
Misisti nummos, quot mihi ? mille, quid est ?
Narrasti nihil, inquis, et à te prodita causa est :
Tanto plus debes, Sexte, quod erubui. [30][78]Mes adversaires ont conclu leur satirique invective en adressant des louanges à Riolan, mais je les tiens pour suspectes et ensorcelées, car il s’agit à la fois de fleurs et d’imprécations, [Page 139 | LAT | IMG] à la manière dont les Anciens ajoutaient un mot de flatterie aux leurs.
Quod si ultra placitum laudarint, bacchare frontem
Cingite, me Medico noceat mala lingua. [31]Cet avertissement de Sénèque me console autrement : Malè loquuntur homines de te. Sed mali. Mouerer, si de me Marcus Cato, si Lælius sapiens, si alter Cato, si duo Scipiones ista loquerentur. Nunc malis displicere, laudari est. Non potest vllam auctoritatem habere sententia, vbi qui damnandus est, damnat. Malè de te loquuntur. Mouerer, si iudicio hoc facerent : nunc morbo faciunt. Non de me loquuntur, sed de se. Malè de te loquuntur. Bene nesciunt loqui : faciunt non quod mereor, sed quod solent. Quibusdam enim canibus sic innatum est, vt non pro feritate, sed pro consuetudine latrent. [79] J’obéirai donc à son autre conseil : Æquo animo audienda sunt
imperitorum conuitia : ad honesta vadenti con-
temnendus est iste contemptus. [32][80]
Je me rappelle avoir lu dans Aristote que rien n’empêche différents inventeurs d’avoir découvert les mêmes choses, en même temps ou en divers temps, sans avoir du tout communiqué entre eux. [33] Je vérifie cela dans la mise au jour des veines lactées, tant mésentériques que thoraciques. « Sache bien, ô lecteur, écrit Pecquet, que tu me dois cette découverte, c’est un présent de la Providence, qui est Dieu, révélant un immense bienfait à un ignorant » ; [81][82] mais Dieu a bien pu accorder cette même grâce à d’autres au même moment dans divers pays. J’observe en effet que les lactifères [Page 140 | LAT | IMG] mésentériques ont été découverts par les médecins et les aruspices de l’Antiquité, puisqu’ils offraient en sacrifice des victimes vivantes bien grasses et qui avaient été copieusement nourries avant d’être tuées : les Latins ont donné le nom de lactes au mésentère à cause des veines lactées qui s’y éparpillent. [34][83][84] Quant à celles du thorax, Mentel, dans l’augmentation de sa lettre de soutien à Pecquet, a affirmé avoir découvert le réservoir en l’an 1629, [85] et l’avoir montré à de nombreux philiatres qu’il avait invités à les contempler ; mais il a voulu que cela fût publié par un jeune médecin de Rouen [86] qui a écrit bien des faussetés sur cette découverte et sur celle de l’imprimerie par un ancêtre de Mentel, [87] qui lui a suggéré ces âneries en vue de diminuer la gloire de Pecquet. [35]Hornius, professeur public d’anatomie en l’Université de Leyde, [88][89] proclame avoir le premier découvert le réservoir et les lactifères thoraciques, et en a écrit un petit livre qui a été publié dans ladite ville.
Rudbeckius, médecin et professeur royal en l’Université d’Uppsala [90] qui est dans le royaume de Suède, affirme avoir été le premier à mettre au jour les lactifères thoraciques et les veines lymphatiques en l’an 1650 ; il les a montrées à la sérénissime reine Christine, [91] qui régnait alors sur son pays, et il a défendu sa découverte dans les opuscules qu’il a publiés contre Bartholin. [36]
M. Guy Patin, professeur royal et notre collègue, a récemment reçu une lettre en français que M. Alcide Musnier, [92] docteur en médecine, lui a écrite de Gênes où il habite depuis vingt ans et exerce avec grand succès, en raison de sa grande érudition et de [Page 141 | LAT | IMG] l’éminente qualité de son jugement ; elle est datée du 14 juillet de la présente année, et je vous la recopie telle qu’elle pour ne pas paraître en avoir changé un mot. [37]
« Ayant vu les vaisseaux lactés du mésentère et de la poitrine, en un chien bien repu, que je fis ouvrir, et ayant lu le traité du sieur Charles Le Noble, qui les a observés dans les hommes, je crois qu’il n’en faut plus douter. Il me déplaît, de ce que le sieur Pecquet ne s’étant pas voulu contenter de sa belle et glorieuse invention, il nous ait voulu de surplus enseigner de certains usages, qu’il eût peut-être mieux valu remettre au jugement des hommes sages, comme Georg Wirsung fit de son canal avec Monsieur Riolan. [93] Il me souvient d’avoir autrefois appris de Monsieur Magnenus, Professeur à Pavie, [38][94] que Gaspare Aselli étant encore en vie, se vantait publiquement d’avoir trouvé de petites veines laiteuses dans la choroïde de l’œil ; et Veslingius de Padoue, [95][96] en une sienne lettre, qu’il écrivait au sieur Molinettus, [97] bien longtemps auparavant que Pecquet nous eut publié son invention, fit une expresse mais bien plus modeste commémoration de ces vaisseaux laiteux du thorax, dont voici les propres termes, que ledit sieur Molinettus, m’a fait l’honneur de me communiquer en une sienne lettre, du 17e d’octobre 1654 : Inter cætera, disait Veslingius, silere nequeo mihi obuenisse pridem in corpore humano per exilia pectoris vasa albi coloris, de quibus multa quidem cœpi cogitare, nihil tamen pronuntiare ausim, priusquam de iis [Page 142 | LAT | IMG] me usus certiorem fecerit ; nosti enim, vt sibi plurimum indulgentes, rerum similitudine etiam periti subinde fallantur. [39] Je vous prie de communiquer cela à Monsieur Riolan mon bon maître et, tout ensemble, de le saluer très humblement de ma part. »Le même Vesling, dans la préface de son Syntagma, note que lui et son adjoint [98] ont examiné la distribution du chyle en direction des mamelles, [99] et il écrit, page 107 : Actionem mammarum propriam lactis generationem dixi, quamuis nondum perspectum satis sit, quibus viis materiam in lac conuertendam admittant. Sed huic rei lactantium animalium à pastu dissectio, lucem aliquam fœnerabitur. [40][100]
Remarquez donc bien, cher Pecquet, que de nombreux médecins de divers pays vous ont dérobé l’honneur de votre découverte, et en tout premier le docteur Mentel qui, dans sa lettre, se vante d’avoir trouvé le réservoir du chyle et d’en avoir fait la démonstration publique dans nos Écoles. Pour que cela fût parfaitement connu de tous, on a façonné à Paris de magnifiques éloges sur l’invention de l’imprimerie par ses glorieux ancêtres, et sur le réservoir du chyle et les veines lactées du thorax qu’il a lui-même été le premier à mettre au jour. S’il n’avait pas voulu que cela fût publié avant d’en connaître le jugement des médecins, il se serait encore tenu longtemps caché, comme Apelle derrière son tableau ; [101] mais pensant que cela méritait d’être reconnu, il se proclame maintenant inventeur de cet artifice chyleux et l’a publié sous le pseudonyme d’un jeune médecin de Rouen, en y ajoutant une réponse à l’opuscule de Charles Le Noble. [41][102] Néanmoins, ce jeune homme, [Page 143 | LAT | IMG] au début du livre qu’il intitule Clypeus, trompette triomphalement, mais sans en comprendre ou savoir le sens, ce vers de Virgile, arma amens capio, que je me permets de compléter :
——————— Nec sat rationis in armis. [42]Je reconnaîtrais cela comme très vrai venant de quelqu’un qui s’y entend quelque peu en anatomie ; et il ajoute : « Voici mon bouclier, il me protégera et j’ai confiance en mon courage. Reconnaissez mes armes car ce sont les vôtres, vous les avez fabriquées de vos propres mains, etc. »
Pecquet n’a pas remarqué que ces deux docteurs de Paris ont tendu un piège à sa réputation et desservent ses intérêts quand ils répartissent la sanguification en l’attribuant à une portion du chyle qui va au cœur et à une autre qui va au foie. Voilà maintenant le foie solidement établi comme l’organe de la formation du sang et comme le meneur de l’économie naturelle. Si Pecquet n’y prête pas attention et ne s’en rend pas compte, furtivis suis coloribus nudabitur, comme la corneille d’Ésope, [43][103] à moins que finalement Alethophilus ne le défende en apprenant qu’il a été abandonné par ceux dont il a usurpé la découverte. [44][104][105]
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |