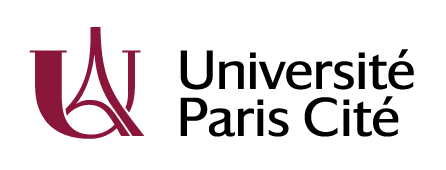Citer ce texte
Imprimer ce texte
| [1] [2] | Appel de note | |
| [a] [b] | Sources de la lettre | |
| [1] [2] | Entrée d'index | |
| Gouverneur | Entrée de glossaire |
Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/pecquet/?do=pg&let=1525
(Consulté le 03/06/2024)
Mode d’emploi
Surgeon de la Correspondance et autres écrits de Guy Patin, Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655) a été conçu et construit avec les mêmes outils informatiques qu’elle et fonctionne comme elle sur une base de 87 textes traduits, assortis de 10 annexes ou pièces liminaires et de 12 biographies, de notes fournissant leurs sources latines (737) et leurs commentaires (1 752), d’un index (4 190 entrées), d’une bibliographie et d’un glossaire (42 mots : chyle, par exemple).Les textes sont classés par ordre chronologique avec, en tête de chacun d’eux, des chevrons permettant de passer au suivant ( > ) ou au précédent ( < ).
La consultation de l’index se fait en entrant un mot-clef dans la fenêtre « Rechercher dans l’index », ou en employant la liste alphabétique des 415 entrées principales. La sélection d’une entrée de l’index, dans la fenêtre de gauche, présente la liste de ses occurrences dans le corpus et un clic sur le numéro d’une d’entre elles affiche, dans la fenêtre de droite, le texte où elle figure, sous la forme d’un nombre vert entre crochets : [1] par exemple. Celle des occurrences qui est numérotée en gras envoie au texte où se trouve la note explicative principale de l’entrée choisie.
Un clic sur les notes numérotées en rouge dans les textes et mises entre crochets, [1], affiche le commentaire qu’elles contiennent dans la fenêtre de gauche.
Les textes et les notes contiennent des liens « hypertexte » (en caractères verts soulignés par un trait pointillé).
- Dans les notes, soit ils donnent (chaque fois que possible) accès aux sources citées, qui peuvent être imprimées ou manuscrites, ou à des notes de la Correspondance et autres écrits de Guy Patin (1 837 liens), soit ils permettent la navigation entre les notes et les textes de notre édition (1620 liens).
- Dans les textes, 737 balises indiquent le numéro de la page traduite, suivi de deux liens : lat donne accès a la transcription latine de la source, et img affiche la numérisation de la page originale imprimée ; par exemple, [Page 157 | LAT | IMG].
Les flèches de recul ( ←, ◄ ) ou d’avancée ( →, ► ) de votre navigateur aident en permanence à retrouver la fenêtre qui a précédé ou suivi celle qui est affichée. Un clic sur l’image située à gauche du bandeau permet à tout moment de revenir à la page d’accueil du site, avec l’affichage du sommaire dans la fenêtre de gauche.
Enfin, le bandeau propose une fenêtre pour « Rechercher dans le texte intégral du corpus ». Tous ces outils autorisent une lecture suivie ou une consultation ponctuelle des textes qui composent notre édition.
Sommaire
Les 720 pages de latin qui sont traduites, annotées et indexées dans La Tempête du chyle proviennent de dix ouvrages, référencés en détail dans la bibliographie et directement accessibles sur la page d’accueil. La Brève histoire du chyle en situe les enjeux scientifiques tels qu’on les a débattus au milieu du xviie s., puis résolus deux siècles plus tard.
- Experimenta nova anatomica de Jean Pecquet, première de deux éditions, Paris, 1651 :
- Experimenta nova anatomica
proprement dites (dédicace, 6 chapitres et 2 figures), exposant la brillante découverte anatomique de la voie thoracique du chyle par Pecquet ;- Dissertatio anatomica de circulatione sanginis et motu chyli, résumé et 12 chapitres ;
- lettres de félicitations écrites à Pecquet par Jacques Mentel, Pierre De Mercenne et Adrien Auzout.
- De Lacteis Thoracicis in homine brutisque nuperrime observatis, Historia Anatomica de Thomas Bartholin, Copenhague, 1652, divisée en 20 chapitres : première démonstration de la voie thoracique du chyle chez l’homme.
- Première Responsio ad Experimenta nova anatomica de Jean ii Riolan, Paris, 1652, préface suivie de 5 parties : refus que le chyle qui monte au cœur y soit transformé en sang.
- Vasa Lymphatica et hepatis exsequiæ de Thomas Bartholin, Copenhague, 1653, chapitre viii : funérailles et épitaphe du foie qui ne fabriquerait plus le sang.
- Experimenta nova anatomica de Jean Pecquet, Paris, 1654, seconde édition revue, corrigée et augmentée de :
- la Nova de thoracis lacteis Dissertatio de Pecquet, épître dédicatoire, préambule et 4 expériences nouvelles ;
- la lettre de Sebastianus Alethophilus (alias Samuel Sorbière) ;
- la Brevis Destructio de la première Responsio de Jean ii Riolan, par Hyginus Thalassius, alias Pierre De Mercenne, en 5 chapitres ;
- la lettre à Pecquet de Mathieu Chastelain ;
- l’Anagramma, poème latin anonyme visant à ridiculiser Jean ii Riolan.
- Trois lettres (1652-1655) de William Harvey exposant son scepticisme sur le chyle (extraites de ses Opera omnia, Londres, 1766, mais échangées par les savants à mesure qu’elles ont été écrites).
- Lettre critiquant l’opinion de William Harvey sur le chyle, par Thomas Bartholin, dans sa Defensio Vasorum lacteorum et lymphaticorum, Copenhague, 1655.
- Observationes raræ et novæ de Venis Lacteis Mesentericis et Thoracicis de CharlesLe Noble, Paris, 1655 : lettre à Jean ii Riolan, réponse de Riolan et son appendice, défendant la fabrication du sang par le foie.
- Clypeus de Guillaume de Hénaut (pseudonyme de Jean Pecquet), Rouen, 1655, en 5 parties : dédié à Jacques Mentel, pour défendre Pecquet et la fabrication du sang par le cœur, contre Charles Le Noble.
- Responsiones duæ de Jean ii Riolan, Paris, 1655 :
- préface au lecteur ;
- Avertissement au lecteur ;
- Seconde Responsio à Jean Pecquet (2 parties) ;
- Lettre aux docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris ;
- Responsio ad Pecquetianos (6 parties), contre les deux docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris favorables à Pecquet, Jacques Mentel et Pierre De Mercenne.
Ressources complémentaires
Avant la mise en ligne de la Tempête du chyle, la Société française d’histoire de la médecine a invité Loïc Capron à présenter son travail dans une conférence d’une heure, le 21 avril 2023 : elle est disponible sur le site de la Société sous la forme d’une vidéo et d’un article publié en ligne (e‑SFHM, 2023, vol. 8, 04).
|
|
"Jean Pecquet et la Tempête du chyle (1651-1655), édité par Loïc Capron." est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International. |