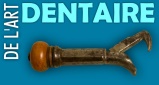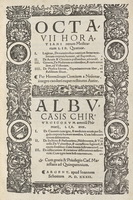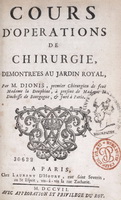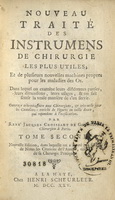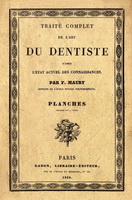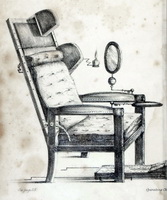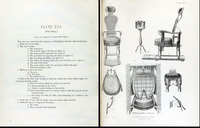L’installation du patient - Les fauteuils
L’installation du patient dans la littérature chirurgicale et
odontologique.
Les premiers fauteuils
Jacques Guillemeau (1549-1613) écrit à la fin du XVIe siècle : « Il faut
situer le malade selon votre commodité ». Sans trop de souci pour le
patient, mais avec un début de recherche ergonomique pour l’opérateur,
presque tous les auteurs, décrivent les mêmes positions des protagonistes
que les iconographiques. Le patient se retrouve donc, comme on l’a vu,
tantôt par terre, sur un coussin, sur un siège bas, la tête souvent
maintenue entre les cuisses ou les genoux de l’opérateur. En 1728, Pierre
Fauchard (1679-1761) dénonce la précarité de toutes ces installations et
recommande l’usage d’« un fauteuil ferme & stable, propre & commode, dont le
dossier sera garni de crin, ou d’un oreiller molet plus ou moins élevé ». Au
XVIIIe siècle, certains experts dentistes qui n’opéraient pas que chez eux
et qui se rendaient également au domicile des patients vont opérer sur des
fauteuils de salon. Des aides pour maintenir la tête du patient étaient
souvent requis. C’est seulement au XIXe siècle que la pratique commence à se
sédentariser et ce sont ces praticiens-là qui vont créer des fauteuils pour,
notamment, incliner et caler la tête du patient du mieux possible. Les
inventifs Maury, Snell, Gresset, Gardette, Rotondo en donnent la
représentation graphique dans leurs ouvrages. Leurs fauteuils, démontrent
sans cesse la volonté de perfectionner et sécuriser la pratique de
l’opérateur et en corollaire d’assurer au mieux le confort de l’opéré.
L’essor métallurgique de la deuxième moitié du XIXe siècle favorisera cette
recherche qui s’accroîtra au fur et à mesure de la diversification des
opérations rendues possibles techniquement, grâce aux progrès et à la
spécification grandissante des instruments et du matériel. Ce sera l’objet
des parties suivantes.
Cliquez sur les vignettes
pour voir l'image agrandie et la légende complète.
Abulqasis (936-1013), in Chirurgia Libri tres, 1532
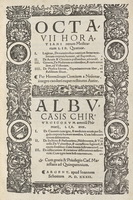
|
Page de titre : Chirurgia Libri tres, Strasbourg, J. Schott, 1532
(BIU Santé 00055) |
|
|
| |
La chirurgie d’Abulcasis, (trad. Lucien Leclerc) 1861

|
Page de titre : La chirurgie d’Abulcasis, traduction de Lucien
Leclerc, Paris, J. -B. Baillière,
(BIU Santé 30707) |
|
|
| |
« Une fois que vous êtes bien certain de l’identité de la dent
douloureuse [...]
Saisissez là avec de fortes pinces, après avoir placé la tête du malade
entre vos genoux et l’avoir fixée, de manière qu’il ne puisse remuer »,
La chirurgie d’Abulcasis, traduction de Lucien Leclerc, Paris, J. -B.
Baillière, p. 98-100
Guillemeau, Jacques (1549-1613), Les Œuvres de chirurgie,1602

|
Page de titre : Jacques Guillemeau (1549-1613),
Les Œuvres de
chirurgie de Jacques Guillemeau, chirurgien ordinaire du Roy et Juré à
Paris, divisées en treize livres. Avec les Portraicts & Figures Anatomiques
de toutes les parties du corps humain. Et des instruments nécessaires au
Chirurgien. Dernière édition. Paris, Nocilas Buon
(BIU Santé 251) |
|
|
| |
« Il faut situer le malade selon votre commodité » , p. 237
Dionis, Pierre (1650-1718), Cours d’opérations de chirurgie, 1707
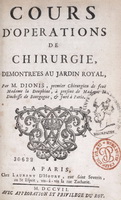
|
Page de titre : Pierre Dionis (1650-1718),
Cours d’opérations de
chirurgie démontrées au Jardin Royal, Paris, Laurent d’Houry ,
1707
(BIU Santé 30622) |
|
|
| |
Pour nettoyer les dents :
« L’opérateur ayant placé la personne, la face tournée au jour, & arrangé
sur un siège ce qui lui est nécessaire, il se met un peu à côté de la
personne assise, & ayant posé un genou à terre pour travailler plus
commodément, il parcourt toutes les dents les unes après les autres »,
p. 507-508
Pour extraire une dent :
« L’on fait asseoir à terre sur un carreau seulement celui à qui on veut
arracher une dent ; l’Opérateur se met derrière lui & ayant engagé la
tête entre ses cuisses il la lui fait un peu hausser, la bouche du patient
étant ouverte il y remarque la dent gâtée afin de ne pas prendre l’une pour
l’autre »,
Pierre Dionis (1650-1718), Cours d’opérations de chirurgie
démontrées au Jardin Royal, Paris, Laurent d’Houry , 1707, p. 516
Garengeot, René Jacques Croissant de (1688-1759), Nouveau traité des
instruments de Chirurgie les plus utiles, 1723
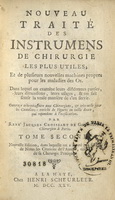
|
Page de titre : René Jacques Croissant de Garengeot, (1688-1759),
Nouveau traité des instruments de Chirurgie les plus utiles, et de plusieurs
machines propres pour les maladies des os, Dans lequel on examine leurs
parties, leurs dimensions, leurs usages, & on fait sentir la vraïe manière
de s’en servir. Ouvrage très-nécessaire aux Chirurgiens, & très utile pour
les Couteliers ; enrichi de Figures en taille douce, qui répondent à
l’explication. Par René Jacques Croissant de Garengeot, chirurgien à Paris.
La Haye, Henri Scheurleer, 1725
(BIU Santé 30818) |
|
|
| |
Pour procéder à une extraction aussi bien avec un pélican qu’avec un
davier : « On fait situer le malade de façon qu’il soit assis par terre ou
sur un coussin, & dans un endroit où le jour éclaire bien. Le Chirurgien
derrière le malade, lui fait appuyer la partie postérieure de la tête sur
les cuisses qui sont un peu approchées l’une de l’autre ».
René Jacques Croissant de Garengeot,
(1688-1759), Nouveau traité des instruments de Chirurgie les plus utiles, p.
63-64
Fauchard, Pierre (1679-1761), Le Chirurgien Dentiste ou Traité
des Dents, 1728

|
Page de titre : Pierre Fauchard (1679-1761),
Le Chirurgien Dentiste
ou Traité des Dents, où l’on enseigne les moyens de les entretenir
propres & saines, de les embellir, d’en réparer la perte & de remédier à
leurs maladies, à celles des Gencives & aux accidens qui peuvent survenir
aux autres parties voisines des Dents. Avec des Observations & des
Réflexions sur plusieurs cas singuliers. Ouvrage enrichi de quarante
planches en taille douce. Par Pierre Fauchard, Chirurgien Dentiste à Paris.
Paris, Jean Mariette, 1728,
(BIU Santé 31332) |
|
|
| |
Vol. I, Chap. XI
La situation du sujet sur lequel on doit opérer ...
« on doit le faire asseoir ordinairement sur un fauteuil ferme & stable,
propre & commode, dont le dossier sera garni de crin, ou d’un oreiller molet
plus ou moins élevé, & renversé suivant la taille de la personne, & surtout
suivant la taille de l’opérateur.
Le sujet étant placé dans un fauteuil, ses pieds portant à terre, son
corps appuïé contre le dossier, ses bras sur ceux du fauteuil, on appuîra la
tête contre le dossier ; on observera de varier les attitudes de sa tête,
suivant qu’il sera nécessaire [...] en un mot dans l’attitude la moins gênante que faire se pourra pour le sujet
& en même temps la plus commode pour l’opérateur », p. 143-144
« S’il s’agit de travailler à ses dents le plus enfoncées dans la
capacité de sa bouche, il ne sera plus question [...] de situer le malade dans un fauteuil, il
faudra lui substituer le canapé, le sopha, ou le lit. S’il est alité, il ne
sera plus question que de le situer le plus favorablement possible à la
faveur d’oreillers ou coussins multipliez suffisamment et bien placez : on
observera la même circonstance si on le situe sur un sopha ou sur un canapé
[...]. la situation du
sujet ainsi couché à la renverse, n’est pas la moins avantageuse. Je suis
surpris que la plupart de ceux qui se mêlent d’ôter les dents, fassent
asseoir ordinairement les personnes à terre ; ce qui est indécent et
malpropre ; d’ailleurs cette situation gêne & épouvante ceux à qui on ôte
des dents, sur-tout les femmes enceintes, cette situation leur et d’ailleurs
très nuisible », p. 147-148
Vol. II, Chap. III.
Manière d’opérer méthodiquement pour nettoyer une bouche, ...
« Pour opérer commodément, on fait asseoir le sujet sur une chaise, ou
sur un fauteuil stable, qui ne soit ni trop haut, ni trop bas, sa tête
mollement appuïée contre le dossier », p. 16
Chap. V. « Pour agrandi, ruginer, & netoyer les trous cariez
[...] on fait asseoir
le sujet sur lequel il s’agit d’opérer, sur un fauteuil convenable & la tête
est appuïée contre le dossier ... », p. 56
Chap. X. « Lorsque les racines ne tiennent pas beaucoup, la personne est
assise sur une chaise basse [...]
Lorsqu’il est question d’opérer aux incisives & aux canines avec le
poussoir, on se met à son choix dans la situation la plus commode : on fait
assujettir la tête du sujet sur le dossier » p. 130-131
« Il est à propos, lorsque ces racines paraissent un peu difficiles à
ôter, que l’opérateur passe derrière le sujet pour lui assujettir la
tête contre son estomac, [...]
Lorsque les racines ou les dents tiennent trop [...] on peut les ôter avec le poussoir en observant
les circonstances qui suivent. On fait asseoir celui sur qui on doit opérer
sur une chaise très basse ; l’opérateur se place derrière, puis étant élévé
au dessus du sujet, il affermit sa tête contre sa poitrine, il pose le
poussoir sur la face extérieure des chicots ou de la dent. Il fait en sorte
que le poussoir réponde en ligne directe au point d’appui sur lequel la tête
se trouve posée : après cela tenant l’instrument dans sa main gauche, il
tient de sa main droite une livre de plomb en mase [...] il frappe sur le manche du poussoir ... »,
Pierre Fauchard (1679-1761), Le Chirurgien Dentiste ou Traité des Dents,
Paris, Jean Mariette, 1728, p.132-133
Bourdet, Étienne (1722-1789), Recherches et observations sur toutes
les parties de l’art du dentiste, 1757

|
Page de titre : Étienne Bourdet (1722-1789),
Recherches et
observations sur toutes les parties de l’art du dentiste, Paris, Jean
Thomas Hérissant, 1757
(BIU Santé 31324) |
|
|
| |
« Pour pratiquer cette opération (redresser les « dents penchées » par
luxation avec un pélican) aux dents de la mâchoire inférieure, il faut
se placer devant le sujet ; au lieu qu’il faut être derrière lui pour opérer
à la mâchoire supérieure. Il faut aussi le faire asseoir sur un siège fort
bas & que sa tête soit renversée sur le dossier du fauteuil, ou, s’il n’y a
point de dossier, sur celui qui opère », p. 23
En revanche, il évoque la présence parfois nécessaire d’un aide
opératoire, en particulier pour cautériser les dents :
« On garnit avec une serviette les parties qui pourroient en être offensées,
comme les lèvres & les joues ; on a aussi une cuillère, pour garantir la
langue, que l’on couvre, & on la fait tenir par un Domestique », Étienne
Bourdet (1722-1789), Recherches et observations sur toutes les parties de
l’art du dentiste, Paris, Jean Thomas Hérissant, 1757, p. 113
Heister, Lorenz (1683-1768) / Paul, François (1731-1774), Institutions
de chirurgie, 1770

|
Page de titre : Lorenz Heister (1683-1768) / Paul, François (1731-1774),
Institutions de chirurgie, où l’on traite dans un ordre clair et nouveau
de tout ce qui a rapport à cet art : ouvrage de près de quarante ans, orné
d’un grand nombre de figures en taille douce, qui représentent les
instruments le plus approuvés et le plus utiles, le manuel des opérations,
les appareils et les bandages, Avignon, J. J. Niel, 5 vol., 1770
(BIU Santé 30668) |
|
|
| |
« Or, voici la meilleure manière de faire l’extraction d’une dent.
Si
elle est à la mâchoire inférieure, on fera asseoir le malade sur un siège
bas, ou même à terre. Si au contraire, elle se trouve à la mâchoire
supérieure, on le placera sur un siège élevé ou sur un lit, quoique dans
l’un ou l’autre cas, il y ait des opérateurs qui le font asseoir à terre ou
sur une chaise basse. », p. 87-88
Laforgue Louis, (?-1816), L’Art du dentiste, 1802

|
Page de titre : Louis Laforgue (?-1816),
L’Art du dentiste, ou manuel
des opérations de chirurgie qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce
que les dentistes font en dents, artificielles, obturateurs et palais
artificiels, Paris, Crouillebois, Barois jeune, Méquignon, Gabon et Comp.,
1802
(BIU Santé 31409) |
|
|
| |
« Chez ceux qui font journellement ces opérations [extractions] , il y a des sièges exprès pour cela .
Il faut que l’opérateur sache opérer, sur une chaise à bas dossier, sur une
pierre, sur une caisse de tambour, par terre, le malade y étant assis ou
couché, aussi bien que dans un fauteuil à dossier, parce que souvent on se
trouve éloigné des maisons où les sièges se trouvent ; dans les camps, dans
les ambulances, et dans beaucoup d’endroits, des cas se présentent où
l’adresse doit suppléer au siège. Dans les cas où le dossier de la chaise
manque, pour y appuyer la tête, une personne, un mur, une cloison, ou un
arbre peuvent y suppléer », Louis Laforgue (?-1816), L’Art du dentiste
Paris, Crouillebois, Barois jeune, Méquignon, Gabon et Comp., 1802, p.
170-171
Conception des premiers fauteuils spécifiques
C’est au tout début du XIXe siècle que les auteurs vont décrire avec
précision un « siège très-commode, propre à bien asseoir tout le corps, à
reposer les bras et à recevoir convenablement la tête » (Gariot). Avec le
tableau de Turner (1808) on constate un premier pas vers un fauteuil
spécialisé. La vraie première représentation d’un fauteuil spécifique date
de 1828 (Maury).
Gariot, Jean-Baptiste (1761-1835), Traité des maladies de la bouche,
1805

|
Page de titre : Jean-Baptiste Gariot (1761-1835),
Traité des maladies
de la bouche, d’après l’état actuel des connaissances en médecine et en
chirurgie qui comprend la structure et les fonctions de la bouche,
l’histoire de ses maladies, les moyens d’en conserver la Santé et la beauté,
et les opérations particulières à l’art du dentiste, Paris,
Duprat-Duverger, 1805
(BIU Santé 72007) |
|
|
| |
« Avant de commencer son opération, le dentiste doit préparer et faire
disposer toutes les choses dont il aura besoin. Il doit avoir un siège
très-commode, propre à bien asseoir tout le corps, à reposer les bras et à
recevoir convenablement la tête pendant une opération qui est souvent longue
; ce siège cependant doit être élégant et ne pas trop sentir l’opération ».
IV partie, p. 252
« ... après avoir fait asseoir la personne sur le fauteuil, mis sur son
épaule une serviette pour essuyer les instrumens, et placé devant elle une
chaise ou une petite table sur laquelle se trouve une cuvette et un verre
d’eau tiède pour rincer la bouche ; [...]
le dentiste commence à nettoyer la bouche de la manière suivante. Il se
place à la droite de la personne, il lui fait pencher la tête sur le dossier
du fauteuil, ou il met un oreiller s’il juge que cela soit plus commode »,
IV partie p. 254
Gariot conseille, comme Bourdet :« il faut que le dentiste ait la
précaution de faire retenir les mains de la personne par un domestique »,
IV partie p. 283
J. M. W. Turner, "The unpaid bill, or the dentist reproving his son’s
prodigality", tableau 1808

|
À gauche, un atelier de prothèse occupe
pratiquement la moitié du tableau. À l’extrême droite on devine le fauteuil
« Cette scène est équivalente aux thèmes de l’alchimiste et surtout de
l’empirique, chers aux peintres de scènes de genre du XVIIe siècle flamand
et hollandais, mais selon les auteurs, on trouve « dans la vaste collection
de Payne Knight [un tableau intitulé] Le laboratoire de l’alchimiste qui, comme ...Le dentiste reprochant la prodigalité de son fils ;
montre un vieil homme en désaccord avec sa famille. Cette peinture a
récemment été attribuée à Gérard Thomas [...] à première vue, [Elle] montre la
pièce bien équipée d’un dentiste au sommet de la profession à la fin de la
grande période du développement professionnel du dix-huitième siècle », BDJ, 2004
|
|
|

|
Fauteuil de salon dans le tableau de Turner, 1808 (détail)
« La chaise est un exemple typique, haute, à dossier rectangulaire, droit
et tapissé [ce sont des] fauteuils avec accoudoirs, utilisés par les
dentistes du temps (Turner l'a arrondi à l’« antique » pour la peinture).
Cette conception de fauteuil dentaire a eu une longue période d'utilisation,
[dès] Snell en 1831 [qui montre] une version avec têtière et dossier
inclinable, ainsi que [un] plateau d'instruments, lumière et miroir, et un
marchepied », BDJ, 2005
M. Bishop, S. Gelbier and J. King
"M. W. Turner’s the unpaid bill, or the dentist reproving his son's
prodigality", British
Dental Journal, vol.197, n°12, 25 décembre 2004, p.757
"Science and technology in Turner’s Georgian dentist’s rooms", British
Dental Journal, vol.198, n°5, 12 mars 2005, p. 299 |
|
|
À gauche, un atelier de prothèse
occupe
pratiquement
la moitié du tableau.
À l’extrême droite on devine le fauteuil |
Fauteuil de salon
dans le tableau de Turner,
1808 (détail)
|
Maury, J.-C. F. (1786-1840), Traité complet de l’art du dentiste
d’après l’état actuel des connaissances, 1828

|
1828 Page de titre : J.-C. F., Maury,
Traité complet de l’art du
dentiste d’après l’état actuel des connaissances, Paris, Gabon 1828
(APHPF00111) |
|
|
| |
Maury, J.-C. F. (1786-1840), Traité complet de l’art du dentiste
d’après l’état actuel des connaissances. Planches (couleurs), 1828
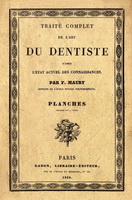
|
Page de titre : J.-C. F. Maury (1786-1840),
Traité complet de l’art du
dentiste d’après l’état actuel des connaissances, Planches (couleurs).
Paris, Gabon, 1828
(APHPF 210) |
|
|

|
Fauteuil du dentiste dont la hauteur est de trois pieds
Pl. XXXII, 4, « le siège sur lequel sera placé l’opéré doit être
commode », J.-C. F., Maury, Traité complet de l’art du dentiste d’après
l’état actuel des connaissances, Paris, Gabon 1828, p. 202
« Ce fauteuil se différencie [...] par des pieds sabre, très cintrés, un dos à
bord supérieur arrondi pour permettre l’inclinaison de la tête vers
l’arrière et des accoudoirs très massifs terminés en volutes »
Claude Rousseau, « Évolution conceptuelle du fauteuil opératoire en
odontologie. Aspect historique. Expérimentation ergonomique », Thèse de 3e
cycle de Doctorat en Chirurgie dentaire, Paris V-Descartes, 1985, p. 23.
|
|
|
| |
Fauteuil du dentiste dont
la hauteur est de trois pieds |
Snell James, A practical guide to operations on the teeth, 1831

|
Page de titre : James Snell,
A practical guide to operations on the
teeth, London, John Wilson, 1831
https://archive.org/details/b21444407
|
|
|
| |
« Il n’y a aucune partie de tout ce qui concerne un dentiste qui n’a plus
d’importance pour sa réussite qu’un bon fauteuil opératoire.
À cet égard, les professeurs de ce pays n’y ont pas porté l’attention
voulue, la plupart n’ayant qu’un fauteuil classique, dont l’usage doit, dans
de nombreux cas, être également gênant pour l’opérateur et fatigant pour le
patient ». Snell se met ensuite à la place du patient qui peut se demander,
à juste titre, si l’opérateur peut être aussi performant pour soigner des
dents maxillaires que des dents mandibulaires. Il conclue : « Ceci,
cependant, peut se faire par l’utilisation d’un fauteuil élaboré sur la base
de principes véritablement scientifiques ». Snell poursuit : « ce
fauteuil facilite la performance de chaque type d’opération » et chaque
dentiste trouvera « avantage à posséder un tel fauteuil ». Il pense que
personne « ne peut [...] fabriquer un fauteuil approprié, sauf sous la
direction d'un bon dentiste ».
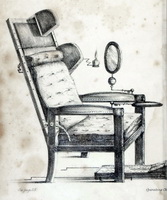
|
Operating chair 1831
Pour la fabrication d’un tel fauteuil il faut tenir compte de trois éléments
principaux.
« Premièrement, le fauteuil doit permettre de placer le patient dans
toutes les positions [...] Deuxièmement, il devrait y avoir attaché tous les
articles [...] qui pourraient être nécessaires [...] [et] qui ne pourraient être
tenus à la main [...] Troisièmement, pour assurer la fermeté de la position du
patient, un appareil pourrait être fixé sur lequel les pieds peuvent se
poser [...] J’ai senti de mon devoir de construire un fauteuil, mieux adapté à
l’objectif »
Snell fournit tous les détails sur son fauteuil : « le cadre doit être assez
lourd ; les pieds fermement fixés au sol [...] il doit être possible de le
mettre complètement à l’horizontale, ou restant à n’importe quel angle
requis par l’opérateur ».
Le dossier mesure près de 1 m 20 en hauteur et le siège au moins 60 cm de
diamètre et il est réglable en hauteur. Snell n’oublie pas de mettre une
première têtière « au sommet du fauteuil, qui devrait être capable de
traverser de droite à gauche » cette partie haute du fauteuil et une
deuxième « sur la partie gauche [...] un coussin souple semi ovale ayant la
forme d’une tête ».
Sont prévus plusieurs coussins de taille différente pour le dos et pour
rehausser le patient, ainsi qu’un marchepied réglable. Il faut également
fixer au fauteuil des « accessoires [...] : sur le bras droit [...] une table
mobile d’environ un pied de circonférence [91 cm] [...] sur le bras gauche est
fixé un miroir puissant ». Ce miroir est prévu pour que le patient puisse
voir et choisir avec le praticien « les dents artificielles ». Snell a prévu
également que le patient « tienne dans sa main gauche une bougie pour
l’utilisation du cautère ». Pour l’éclairage, si c’est nécessaire, c’est
beaucoup mieux d’avoir « de la cire blanche épaisse placée dans un [support]
[...] fixé sur le bras gauche du fauteuil, près du dossier ». Ce support doit
avoir plusieurs zones où placer la cire « en face de la bouche ».
(Traduction partielle de Snell James, A practical guide to operations on
the teeth, London, John Wilson, 1831, p. 56-70)
1831
(Ce fauteuil fait partie du groupe des fauteuils mécaniques dont le système
de levage est situé sous le siège : mécanisme à crémaillère ou à vérin à
vis ». Le modèle de Snell a une base et un corps qui ne sont dissociés ;
Claude Rousseau, Évolution conceptuelle du fauteuil opératoire en
odontologie. Aspect historique. Expérimentation ergonomique, Thèse de 3e
cycle de Doctorat en Chirurgie dentaire, Paris V-Descartes, 1985, p.
24-25.) |
|
|

|
Snell James,
A practical guide to operations on
the teeth, London, John Wilson, (texte integral p. 56-70)
>>> DOSSIER |
|
|
Operating chair 1831
Pour la fabrication d’un tel
fauteuil il faut tenir compte
de trois éléments
principaux. |
DOSSIER
(15 images)
|
Maury, J.-C. F. (1786-1840), Gresset Paul, Traité de l’art du dentiste d’après l’état actuel des connaissances.
Planches, 1841

|
Page de titre : J.-C. F. Maury (1786-1840), Gresset Paul,
Traité
complet de l’art du dentiste d’après l’état actuel des connaissances,
Planches. Paris, Just Rouvier, 1841
(APHPF 101) |
|
|

|
Fauteuil de Gresset, 1841
Ce fauteuil de Gresset diffère de celui de Maury par ses pieds antérieurs
à balustre et surtout par le dossier dont la têtière est inclinable.
« Il est de forme carrée, à dossier droit un peu penché en arrière. Les
pieds de derrière doivent être cintrés et saillants, afin d’éviter que les
efforts du malade ne puissent renverser le fauteuil dans cette direction.
[...] Les accotoirs (ou
bras) sont à manchettes, et placés à 16 centimètres au-dessus du siège.
Le dossier a une longueur totale de 75 centimètres, à partir du siège. La
première partie fait 50 centimètres de long, et l’extrémité supérieure 25
centimètres. Ces deux parties sont réunies par deux charnières. L’extrémité
supérieure est garnie de deux joues d’environ 20 centimètres de large. Ces
joues sont garnies d’une lame d’acier un peu courbe, d’environ 3 centimètres
de large sur 3 millimètres d’épaisseur. Cette lame est percée de trous très
rapprochés dans toute sa longueur. L’extrémité inférieure est percée de
trois trous au moyen desquels sont fixées au fauteuil par des vis.
L’extrémité supérieure est garnie d’un goujon d’acier d’un centimètre de
long qui entre dans les trous de la lame courbe. Sur l’autre face de la même
extrémité est un bouton ou anneau, pour tirer la lame de façon à pouvoir
changer le goujon de trou, et par ce moyen donner à l’extrémité supérieure
du dossier le degré de renversement nécessaire à l’opération. Le siège, les
manchettes et le dossier du fauteuil doivent être rembourrés en crin, et
recouverts de velours ou de maroquin. » (Légende de la planche XLII)
Ce fauteuil doit être classé dans la même catégorie que celui de Snell :
levage sous le siège + base et corps solidaires. J.-C. F. Maury (1786-1840),
Gresset Paul, Traité complet de l’art du dentiste d’après l’état actuel
des connaissances, Planches. Paris, Just Rouvier, 1841, Pl. XLII,
(détail) |
|
|
| |
Fauteuil de Gresset, 1841
Ce fauteuil de Gresset diffère
de celui de Maury par ses
pieds antérieurs
à balustre
et surtout par le dossier dont
la têtière est inclinable. |
Goddard Paul B. et Parker Joseph E., Anatomy,
physiology and pathology of the human teeth, Philadelphia, Carey and
Hart, 1844

|
Page de titre : Paul B. Goddard et Joseph E.,
Anatomy, physiology and
pathology of the human teeth, Philadelphia, Carey and Hart, 1844
Source de l'image
|
|
|
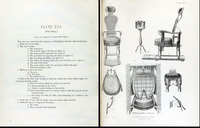
|
« Operating chair » d’Émile B. Gardette
Paul B. Goddard et Joseph E. Parker,
Anatomy, physiology and pathology
of the human teeth, Philadelphia, Carey and Hart, 1844. Pl 21, p.
246-247.
Ce fauteuil d’Émile B. Gardette conçu entre 1835 et 1840 est le premier
fauteuil à têtière et à système de levage à crémaillère. Apports en
comparaison de celui de Snell : têtière détachée du dossier rétréci dans le
bas, accoudoirs cintrés épousant le galbe du siège. (Histoire du cabinet
dentaire, Claude Rousseau),
Ce fauteuil doit être classé dans la même catégorie que celui de Snell :
levage sous le siège + base et corps solidaires
|
|
|
| |
« Operating chair » d’Émile B. Gardette |
Rotondo Antonio (1808-1879), Tratado completo
de la estraccion de los dientes, muelas, y raigones y modo de limpiar la
dentadura, 1846

|
Page de titre : Antonio Rotondo (1808-1879),
Tratado completo de la
estraccion de los dientes, muelas, y raigones y modo de limpiar la dentadura,
Madrid, Perez, 1846
(Fac simile, AACHE Ediciones 1516)
|
|
|

|
Fauteuil de chirurgien dentiste
Antonio Rotondo (1808-1879),
Tratado completo de la estraccion de los dientes,
muelas, y raigones y modo de limpiar la
dentadura, Madrid, Perez, 1846, Pl. 1., p. 143
|
|
|
| |
Fauteuil de chirurgien dentiste |
« Un assistant tiendra les mains du patient pour éviter qu’il ne prenne
celles de l’opérateur . [...]
Quant au mouvement de rejet de la tête, non moins dangereux que le précédent
pour le succès de l’opération, il est facilement évité en disposant d’un
fauteuil avec un creux pour y poser la tête et d’un dossier mécanique pour
l’ajuster à la hauteur de toutes les têtes », Antonio Rotondo
(1808-1879), Tratado completo de la estraccion de los dientes, muelas, y
raigones y modo de limpiar la dentadura, Madrid, Perez, 1846, Fig. 1.,
p. 28-29
|